C’est possible: Mamadou Igor Diarra : Soigner les déviances du pouvoir et sortir le Mali du précipice
C’est un extrait du livre de Mamadou Igor Diarra «C’est possible». Un homme d’État et dirigeant de banque malien, est riche en virages et rebondissements. Au sommet de la hiérarchie de grandes banques ouest-africaines (BDM, BIM, Bank Of Africa) ou au sein des gouvernements qui l’ont appelé (ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Eau de 2008 à 2011, puis ministre de l’Économie et des Finances de 2015 à 2016), son action n’a jamais dérogé à ce dessein. Un défi dans un pays pauvre, où privilèges et corruption sont monnaie courante. «C’est possible au Mali» est un appel à une prise de conscience, au rassemblement et à l’action pour un Mali, où il fera mieux vivre pour tous.
Est-il possible de définir le pouvoir ? L’imaginaire qui l’accompagne est souvent habité par l’image de la toute-puissance. Il est président, elle est ministre: ils peuvent tout. J’ai été ministre de l’Économie et des Finances du Mali, un pays aux ressources publiques modestes. Que je le veuille ou non, mon pouvoir était bordé par les limites du budget et de la loi. Cette révérence coutumière qui entoure les dépositaires de la souveraineté est en grande partie symbolique; elle ancre leur toute-puissance. Elle est aussi liée à un mal que nous, les Maliens, connaissons tous, une tentation qui hante l’appareil d’État de haut en bas: la paralysie !
À défaut de pouvoir faire avancer les choses, il est possible de les bloquer. Et si la situation est au point mort, il est possible de faire commerce de leur déblocage… Alors, la quasi-toute-puissance est assurée !
Dans cet enchevêtrement de circonstances, ceux qui assument les hautes charges de l’État sont souvent désespérément seuls. Un jour, un ancien président du Mali avait lancé dans le feu d’une improvisation: «il faut être fou pour vouloir diriger le Mali» !
Notre sagesse populaire dit: «On peut diriger un troupeau avec un seul bâton, mais pour diriger des humains, il faut un bâton par personne».
Dans un pays en pleine mutation, où chacun cherche sa voie, il faut effectivement un peu de folie pour se risquer à assumer des responsabilités publiques. L’univers du pouvoir est complexe. Dans nos pays, il est principalement incarné par l’exécutif au premier rang, par le chef de l’État, ses ministres, les responsables des institutions. Mais ces responsables ne sont que des humains ; ils ne peuvent agir, connaître, comprendre et décider seuls.
Par la force des choses, ils sont entourés de proches, du protocole, des forces armées et de sécurité, tout à la fois surveillés et parfois servis par la justice. Ce beau monde se trouve réglé par des rites étrangers au commun des mortels, souvent étanches aux réalités de la vie normale, un environnement où tout est préconçu, souvent biaisé. Cirque ou comédie ? Pour être un bon leader, il faut être un bon acteur. Au Mali plus qu’ailleurs.
Une autre caractéristique du pouvoir est liée au verrouillage de cet univers, où les nouveaux venus sont souvent vécus comme de potentielles menaces. Ce verrouillage explique la forte proportion d’hommes et de femmes de pouvoir qui ont fait de cet art leur métier, et dont certains ont même dépassé l’âge de la retraite. Une situation relativement récente d’ailleurs. Modibo Keïta avait quarante-cinq (45) ans en 1960; Moussa Traoré est devenu président à trente-deux (32) ans. Il ferait aujourd’hui figure de bambin.
Dans un pays comme le Mali, où 85% de la population est née après l’accession de ces hommes au pouvoir, le vieillissement de la classe dirigeante finit par poser un vrai problème. Sans parler de la force physique et mentale nécessaire à des missions qui, à cette étape de notre histoire, requièrent certes de l’expérience, mais aussi une énergie intacte. Pour faire «bouger les lignes», la compétence ou la volonté ne suffisent pas. Ceux qui ont le pouvoir de changer les choses sont les politiques, car ils sont investis de la légitimité populaire. C’est d’ailleurs ce qui m’a valu mes entrées et sorties du gouvernement.
Les politiques vous appellent pour votre compétence, jusqu’au jour où ils n’en ont plus l’utilité ou que leurs stratégies électorales les poussent à d’autres besoins. Les politiques craignent parfois les compétences. C’est pourquoi il faudrait doubler les aptitudes des technocrates par une légitimité politique.
Observons à présent la question des programmes proposés par les candidats à l’occasion des élections. Il s’agit, le plus souvent d’un recueil d’intentions, de fanfaronnades, piochées ici et là. J’ai pu me rendre compte que certains candidats ne prenaient même pas le temps de lire attentivement ces catalogues de mesures souvent techniques. «Projet de société» est devenu une formule à la mode, un passage obligé de tout programme. Souvent, ceux qui officiellement les portent et en usent, peinent à en transmettre la logique.
La courtisanerie qui entoure les chefs est la mère de leur solitude. Peu d’échanges vrais, ils sont comme le disait Me Mohammed Ali, le célèbre boxeur américain, des hommes et des femmes à qui l’on serine à longueur de journée: «Tu es le plus grand, le plus beau, le plus fort». Il faut une grande force d’âme pour ne pas accorder un peu de crédit à ces flatteries.
Largement coupé du monde réel, peu au fait de ce qui se passe vraiment dans la société, le chef est pourtant submergé d’informations dispensés par sa cour: ragots, versions tronquées, fausses promesses, complots imaginaires, calomnies contre d’éventuels concurrents…Comment trouver le temps de réfléchir, de faire le tri, de trancher ? Agir comme les courtisans le suggèrent pour conserver l’illusion d’être toujours «le plus grand, le plus beau, le plus fort» ? Ou mettre les mains dans le cambouis et les pieds dans les flaques boueuses d’un pays où plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, où tout est urgent, souvent vital ?
Les hauts dirigeants africains dorment peu, reçoivent beaucoup, écoutent beaucoup, font beaucoup de discours, voyagent beaucoup, président beaucoup de cérémonies…C’est peut-être ça leur travail: faire beaucoup. Leur principale difficulté est la gestion d’un temps qui ne suffit jamais à gérer l’essentiel et à donner les impulsions nécessaires à l’essor de la société. En comparaison, avec notre connaissance de la façon dont agissent les chefs des États qui ont une longue histoire d’organisation étatique derrière eux, le travail de nos palais est comme le dit l’adage bamanan: «le fossé entre le poisson séché et le fleuve». C’est encore plus vrai pour les fonctions ministérielles.
L’insuffisance du temps consacré à l’essentiel est d’autant plus dommageable que bien des habitudes de notre système étatique compliquent à souhait l’action ministérielle. Je me rappelle une expression du regretté Mandé Sidibé, ancien Premier ministre de 2000 à 2002 avec lequel j’étais lié par une estime mutuelle: «Le grand gâchis de nos États, c’est le coût de la rupture», disait-il. Cet économiste chevronné évoquait par cette formule le peu de souci de la continuité de l’État lorsqu’un ministre prend la succession d’un autre et succombe à la tentation de se distinguer à son tour.
Dans les pays qui ont une longue tradition administrative, le nouveau ministre hérite de services organisés, d’archives consultables, d’orientations politiques, d’une mémoire. Il peut changer de cabinet, mais il n’est pas question de distribuer des postes à ses amis sur tout le territoire.
En Afrique, c’est bien souvent un grand balayage qui fait voler en poussière la mémoire de l’État. Mandé Sidibé avait tellement raison: pour la nation, le «coût de la rupture», même s’il est impossible à évaluer, est vertigineux.
J’ai un jour tenté de l’expliquer à Michel Sapin, ministre des Finances dans le gouvernement français sous la présidence de François Hollande. Pour assainir les finances de l’État malien et alléger le poids des difficultés techniques liées à nos imperfections administratives, j’avais adressé une demande d’annulation de notre dette monétaire vis-à-vis de la France, soit une somme de 46 milliards de Francs CFA.
J’argumentai ainsi:
- Monsieur le ministre, certes, nous avons sur le papier les mêmes attributions, mais nous ne faisons pas le même travail. Je suis ministre de l’Économie et des Finances d’un pays en guerre. Ma priorité, chaque mois, est de boucler les salaires. La France ne peut-elle pas renoncer à une dette dont la gestion et le remboursement sont très complexes dans nos conditions de fonctionnement ?
Puis je lui expliquai plus en détail la nature de ces complications. Il me comprit rapidement. Sa réponse vint lors de la réunion de la zone franc qui suivit notre entretien. J’en étais le ministre hôte. Michel Sapin annonça formellement au président Ibrahim Boubacar Keïta l’annulation pure et simple de cette dette. Je lui en serai éternellement reconnaissant. Nous avons depuis maintenu des liens d’amitié et de confiance.
L’exercice du pouvoir dans nos pays se déroule donc dans un contexte de vertige, mais se heurte ensuite généralement à ses limites. Au-delà des règles de la démocratie et des limites aux pouvoirs de l’exécutif fixé par la Constitution, l’environnement de nos gouvernants entrave leur capacité à diriger efficacement dans le sens de l’intérêt public.
Mamadou Igor DIARRA, ancien ministre de l’Économie et des Finances
Extrait de son livre «C’est possible au Mali».
Quelle est votre réaction ?
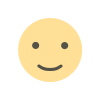 Like
0
Like
0
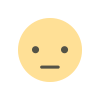 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
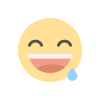 Drôle
0
Drôle
0
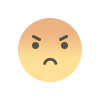 Hmmm
0
Hmmm
0
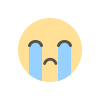 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0
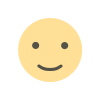 Like
0
Like
0
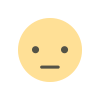 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
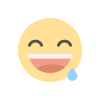 Drôle
0
Drôle
0
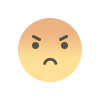 Hmmm
0
Hmmm
0
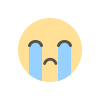 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0












































