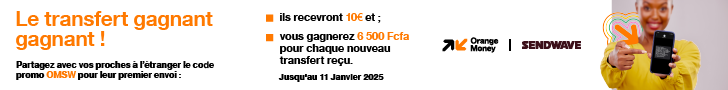Djibril Traoré, nous le savions, est habituellement maître de son art. Mais peut-être a-t-il simplement rempli, hier sur les écrans de l’ORTM son contrat historique en reconstituant la grande fresque en cinquante ans de nos clubs ainsi que de nos sélections nationales de football. L’exercice n’est pas des plus aisés. Pour plusieurs raisons : le nombre dissuasif des joueurs et la diversité de générations d’équipes qui se succèdent sur une telle durée ; l’impossibilité de reconstituer les témoignages-clés parce que certains acteurs sont morts, malades ou difficiles à localiser ; la pénibilité de la tâche car il s’agit de construire une histoire à partir d’archives généralement mal tenues et incomplètes.
Naturellement, tout le monde n’était pas là, des noms peuvent avoir été oubliés, des rôles essentiels en leur temps omis ou insuffisamment mis en relief, des séquences de matchs épiques peuvent manquer. Mais le temps donné au brillant reporter sportif n’était pas élastique et Djibril a méritoirement relevé le défi du cinquantenaire : revoir d’où nous venons, où nous sommes arrivés, comment nous y sommes arrivés, ce qui a fait nos réussites, ce qui explique nos échecs et à quel futur travaillons-nous.
La trame de la grande fresque était limpide : il s’agissait de proposer notre football actuel à la lecture critique de la génération pionnière, ces Mbaye Elastique, Piantoni, Nani, Blocus qui pleuraient dès que l’hymne national retentissait, qui jouaient pour la seule patrie et remportaient des victoires au nom de cette seule patrie. Exemple : la Fédération du Mali venait d’éclater, Modibo Keita est presque chassé de Dakar, la tension est vive entre le Soudan et le Sénégal. C’est dans un tel contexte que, par la cruauté du tirage au sort, la République du Mali devait rencontrer la République du Sénégal. L’esprit de Coubertin, peut-être bien. Pourtant, ce jour l’essentiel n’était pas seulement de participer mais aussi et surtout de gagner.
Et ils ont gagné, ces braves « Soudanais ». Raconté par les acteurs Nani, Laïs, Blocus, le derby tenait simplement d’une épopée difficile à imaginer aujourd’hui et à faire admettre par les joueurs d’aujourd’hui. Arrivèrent ensuite le temps des grands clubs et le règne des Aigles du Mali. Deux finales malheureuses : d’abord, en 1966, avec la coupe d’Afrique des Clubs à Abidjan où le Réal de Bamako à son faîte s’est incliné devant le Stade d’Abidjan de Bamako ; et ensuite la finale de la Coupe d’Afrique des Nations en 1972 à Yaoundé où l’équipe nationale du Mali tombera devant le Congo Brazzaville.
Avec les mêmes dénominateurs : des Maliens favoris sur le papier mais comme frappés d’un signe indien ; l’héroïsme ingrat comme celui de Cheickh Diallo sortant dans les vestiaires sa chaussure pleine de sang : un Salif Keita payant cruellement pour son statut d’icône et taxé de déficit d’amour patriotique, sinon d’avoir simplement vendu le match ; des supporters inconditionnels de leur club et du onze national comme on en trouve de moins en moins.
Puis survint la longue éclipse avec une traversée du désert peu acceptable pour un pays bourré de talents. Qu’il s’agisse de Metiou Maiga, Mbaye Elastique ou Mockey Diané, l’explication est claire : une équipe n’est pas la juxtaposition de ses talents -ils reconnaissent que notre pays a encore de grands footballeurs- mais la synergie de ses talents, donc leur volonté ou leur aptitude à collaborer sur le terrain, mus par la seul sentiment de se battre pour le pays, rien que pour le pays. La génération actuelle de joueurs qui évoluent dans les grands championnats européens n’a pas trouvé grâce aux yeux de leurs aînés.
Elle mérite, sans doute, un peu plus d’indulgence : elle a été de presque toutes les phases finales depuis 1994. Elle nous a fait rêver en 2002 et après. Mais elle est chaque fois tombée de manière peu honorable alors que le pays y avait cru à chaque fois. Dommage que le producteur n’ait pas recouru aux explications des Djilla, Seydou Keita et autre Kanouté pour que nous sachions les raisons structurelles à ces naufrages systématiques au port. Mais en gros, on ne peut pas oublier et c’est par cela que pêche la théorie des anciens : le football de Piantoni n’est plus possible en 2010.
Les différences entre les équipes se réduisent considérablement, la tactique a évolué, tuant la beauté du jeu et chaque erreur peut-être fatale. Il est vrai, hélas, que nous voyons plus sur le terrain le gros cœur qu’y mettaient les aînés. Il est hélas vrai qu’on ne laisse plus traîner dans le camp adverse une jambe qui vaut de l’or en Europe mais très peu dans une sélection africaine.
On ne parle même pas des batailles sourdes à livrer pour empocher ses primes ni du chancre des fédérations nationales de football qui ne sont pas des chefs d’œuvre de droiture ou d’abnégation. En fait, rien ne se perd, tout se tient et tout déteint sur tout. Si le prochain cinquantenaire l’intègre, nos enfants qui pleurent à chaque défaite de nos Aigles étrenneront, un jour, les Coupes qui manquent jusque-là à notre palmarès.
Adam Thiam