Portrait (2/3) · Enseignante, militante marxiste et féministe, députée : Bintou Sanankoua a mené une vie de luttes dès les années 1960, à une époque où « la femme suivait son mari ». Pour l’historienne Madina Thiam, il est urgent de relire ses écrits, qui offrent un antidote contre les dénis d’histoire et esquissent une voie panafricaine et démocratique pour les sociétés ouest-africaines. Portrait en trois épisodes.
À la fin des années 1970, l’étude de l’histoire de l’Afrique précoloniale est en plein essor. Une première génération d’historiens africains, évoluant pour la plupart entre Dakar et Paris, s’était attelée, à partir du milieu des années 1950, à réhabiliter le passé de l’Afrique de l’Ouest, tout en travaillant à bâtir son futur.
Il s’agit notamment d’Abdoulaye Ly, Cheikh Anta Diop, Joseph Ki-Zerbo ou encore Sékéné Mody Cissoko. Dans les années 1970, une seconde génération, à l’instar d’Henriette Diabaté, Madina Tall, Abdoulaye Bathily et Boubacar Barry, suit la première et combine, comme elle, recherche scientifique et engagement militant. C’est au sein de cette dernière que s’inscrit le parcours de Bintou Sanankoua.
En 1979, elle rejoint le Centre de recherches africaines, au 9 rue Malher, à Paris, où un ancien camarade du Parti malien du travail (PMT) l’a mise en relation avec le professeur Yves Person. Ancien administrateur colonial, plus tard employé du ministère de l’Éducation nationale de Côte d’Ivoire, puis enseignant et chef du département d’histoire à l’université de Dakar, celui-ci a publié, quelques années plus tôt, une thèse monumentale, Samori : une révolution dyula, issue de quinze années de recherche mêlant archives écrites et sources orales.
Rue Malher, Bintou Sanankoua suit également les cours d’histoire africaine de Jean Devisse, Claude-Hélène Perrot, Jean-Pierre Chrétien, ainsi que ceux dispensés par d’autres historiens à la Sorbonne et à Paris VII, notamment Catherine Coquery-Vidrovitch et Jean-Louis Triaud. Elle évoque cette époque avec nostalgie : « C’était le foisonnement ! »
Elle décrit une atmosphère d’effervescence intellectuelle, épurée de toutes barrières hiérarchiques entre les professeurs et la dizaine d’étudiants originaires d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale. On lit, on discute, on débat et on écrit. Finalement, à l’heure de choisir un sujet de thèse, le thème « s’impose à [elle] ».
Ce sera un retour aux sources : sa région natale, et l’éphémère théocratie qu’a érigée Seku Amadu Bari dans le Delta, à Hamdallahi, au XIXe siècle. Ce choix, motivé par le désir de travailler sur une époque majeure de l’histoire du Mali, est également pragmatique : elle sait qu’elle pourra compter sur l’appui et les archives de celui qu’elle appelle affectueusement « le vieux ».
Aux côtés du « vieux »
Retour en arrière. Nous sommes en 1958, Amadou Hampâté Bâ vient de fonder l’Institut des sciences humaines de Bamako. Il espère également ouvrir, à terme, un institut de tradition peule à Sévaré, dans la banlieue de Mopti.
Ancien employé de l’Institut fondamental d’Afrique noire (Ifan), à Dakar, également passé par l’Unesco, à Paris, Amadou Hampâté Bâ entend faire de ces instituts des plaques tournantes de la recherche. Écrivain, chercheur, fonctionnaire, il a déjà à cette époque une longue carrière à son actif. Il a parcouru toute l’Afrique Occidentale française (AOF), dispose d’une grande renommée et d’un solide carnet d’adresses.
Ainsi, sa concession familiale, rue 14, dans le quartier de Médine, à Bamako, ne désemplit pas : amis, personnalités politiques, chercheurs, griots s’y succèdent. Toute une aile de la résidence est réservée aux proches et à la famille venue de Bandiagara, sa ville natale, située dans le centre du Mali.
Dans la cour, on croise également des jeunes gens venus vivre ou étudier à la capitale, qui ont été confiés au chercheur et à son épouse Baya Diallo. Alors, lorsque sa fille doit quitter le cocon familial de Mopti pour se rendre à Bamako, c’est évidemment chez son ami Hampâté que le docteur Sanankoua l’envoie. Et si Bintou Sanankoua affirme que c’est peut-être là, alors qu’elle assistait au bal d’hommes politiques qui se succédaient à la concession de la rue 14, que son engagement militant est entré « en gestation », nul doute que les années passées auprès du « vieux » ont également semé les germes de son parcours d’historienne.
Je suis arrivée chez A. H. Bâ à son domicile bamakois de Médine en 1958, et je n’en suis jamais pratiquement partie, malgré une carrière professionnelle et une vie de famille indépendante à partir de 1970. Je l’ai côtoyé de très près pendant toutes ces années, vécu avec lui dans toutes ses résidences, beaucoup discuté avec lui sur des sujets divers.
Quelques années plus tôt, en 1955, Amadou Hampâté Bâ et son collaborateur Jacques Daget publiaient le premier volume de L’Empire Peul du Macina. Quinze années durant, Amadou Hampâté Bâ a sillonné le Delta et collecté plus d’un millier de témoignages et de traditions orales.
Il les compile et en tire cet ouvrage, un récit sur la Dina du Macina, et sa capitale, Hamdallahi. L’État musulman, fondé en 1818, est le fruit d’une révolution menée par Seku Amadu Bari contre les élites religieuses et commerçantes de Djenné et de Tombouctou, et la tutelle des rois de Segu (Ségou). Moins d’un demi-siècle après sa fondation, la Dina tombe, envahie en 1862 par les troupes du chef musulman El Hadj Omar Tall, venu du Fuuta Tooro, au nord du Sénégal actuel.
Vieilles blessures
Ce premier volume de L’Empire Peul du Macina couvre les années 1818-1853. Le second volume, pourtant annoncé, se fait attendre. L’ouvrage retracera la conquête omarienne du Delta, et la guerre fratricide qui opposa les communautés musulmanes du Fuuta et du Delta, toutes deux de langue et culture peules.
Mais dans le Delta, les blessures enfouies subsistent sur le temps long. Un siècle après la chute de Hamdallahi, la mémoire de la Dina et le choc de l’invasion sont encore vifs ; le « vieux », ne souhaitant pas réveiller de vieilles blessures, temporise. Il décide qu’il ne publiera pas la suite de l’ouvrage, se remémore Bintou Sanankoua, « tant qu’il y aura une personne concernée encore vivante ».
À ce jour, plus de trente ans après le décès d’Hampâté Bâ, le second volume n’a toujours pas été publié. Pourtant, il est entièrement rédigé, affirme-t-elle. Elle le sait, car elle a passé énormément de temps dans le bureau et les archives d’Hampâté. À la rue 14, elle est souvent à ses côtés en ce début des années 1960, échange beaucoup avec lui et lui sert de secrétaire. Le vieux apprécie la compagnie de cette jeune fille curieuse et déterminée. C’est pour cela que des années plus tard, pour Bintou Sanankoua, la décision d’entamer une thèse doctorale sur la Dina ira de soi : « J’avais la matière sous la main ! »
Au début des années 1980, dans le cadre des recherches qu’elle effectue pour cette thèse, elle aussi parcourt le Delta, en quête de sources orales et écrites : à Hamdallahi, Worongya, Sokoura, Djenné, Fatoma, Mopti, Tombouctou, elle recueille témoignages et manuscrits, dont de nombreux textes en langue peule rédigés en alphabet arabe. Elle collabore avec les chercheurs Ali Koulogo et Boubacar Diagayété, à qui Hampâté espère confier la direction de l’institut de Sévaré (qui ne verra finalement jamais le jour).
Contrairement à l’ouvrage d’Hampâté Ba et Daguet, récit épique qui se lit comme un roman, l’étude de Bintou Sanankoua est organisée de façon thématique, détaillée et systématiquement sourcée. Elle retrace la façon dont la Dina bouleverse le cours de l’histoire dans le Delta en réorganisant entièrement l’administration, l’économie et les sociétés de la région. Dans un pays vivant au rythme des crues et des transhumances, les autorités de Hamdallahi se sont attelées à réguler les systèmes pastoraux, agricoles, et fonciers.
Un État ouest-africain sophistiqué
Son étude montre également toute la sophistication de cet État ouest-africain, qui instaura l’éducation obligatoire pour les filles et les garçons, établit des relations diplomatiques avec le puissant sultanat de Sokoto (dans le Nigeria actuel), et était gouverné sous l’égide du Batu Mawdo, une assemblée de quarante savants qui se réunissait quotidiennement pour débattre et assister le souverain dans ses pouvoirs législatifs et exécutifs.
Un siècle après la conquête d’El Hadj Omar, Yambo Ouologuem, autre natif de la région, puisera dans l’histoire tourmentée et la tradition littéraire de la Dina pour écrire son fameux roman, Le Devoir de violence (Seuil, 1968). En 1982, à Paris, Bintou Sanankoua soutient sa thèse, « L’Organisation politique du Maasina (Diina), 1818–1862 », une étude monumentale de 1 076 pages.
Doctorat de troisième cycle en poche, Bintou Sanankoua rentre au Mali la même année, et intègre le corps professoral de l’École normale supérieure (ENSup) de Bamako. Une génération exceptionnelle d’historiens maliens anime alors le département d’histoire-géographie, à l’instar de Drissa Diakité, Adame Ba Konaré, Mohamédoune Dicko et Doulaye Konaté. C’est au cœur de ce vivier intellectuel que Bintou Sanankoua publie l’article « Les écoles “Coraniques” au Mali : problèmes actuels » (Revue canadienne d’études africaines, 1985), et avec Drissa Diakité, Bamako, fleur des savanes (la ville hier et aujourd’hui) (Gouvernorat du district de Bamako, 1987).
Deux ouvrages suivront en 1990 : La Chute de Modibo Keïta (Éditions Chaka), dans le cadre de la collection « Afrique contemporaine » dirigée par le Guinéen Ibrahima Baba Kaké, ainsi qu’une version condensée et remaniée de sa thèse, Un empire peul au XIXe siècle.
La Diina du Maasina (Karthala), qui reste à ce jour l’un des ouvrages de référence sur Hamdallahi. L’année suivante, elle coordonne et publie un ouvrage collectif, L’Enseignement islamique au Mali (Jamana & SOAS), avec l’historien Louis Brenner. Nous sommes alors à l’aube des années 1990, et le Mali est sur le point de vivre une révolution politique. Là aussi, Bintou Sanankoua sera « actrice et témoin » des bouleversements à venir.
(À suivre...)
Madina Thiam/ www.afriquexxi.info

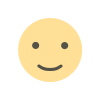 Like
0
Like
0
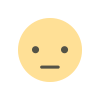 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
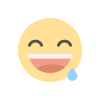 Drôle
0
Drôle
0
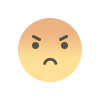 Hmmm
0
Hmmm
0
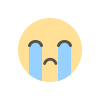 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0













































