En dépit de la crise, et de ses effets pervers, les populations tentent, avec un certain succès, de mener une vie normale. Ou presque. Carnet d’un retour dans mon Goundam natal.
Jeudi 18 mai, Goundam, quartier Haribanda, 11h30 mn. Une chaleur de plomb. Près de 50° à l’ombre. Pas un souffle de vent dans les dattiers sauvages, qui bordent la route au bitume dégarni. Le soleil est, déjà, haut dans un ciel assombri, par endroits, par de gros nuages poussiéreux.
Malgré tout, la circulation est dense. Très dense. A moto, en voiture ou en charrette tirée par des ânes, les populations vaquent à leurs occupations. Armés de mitraillettes, avec à leur bord des soldats cagoulés, trois véhicules militaires traversent le quartier à vive allure, sous le regard amusé des enfants.
Une vie, presque, normale
Longtemps considéré comme un quartier dortoir, le quartier Haribanda (derrière le fleuve) est devenu, en l’espace d’une décennie, le quartier résidentiel de la « ville des lacs ». Avec ses bâtiments en dur construits, parfois, à deux niveaux ; ses rues en bitume, ses jardins fleuris, il donne l’image d’un quartier d’avenir.
« C’est le quartier des fonctionnaires et de tous ceux qui disposent d’un peu de moyens », nous confie un passant, constatant notre surprise face à ce changement.
C’est de là, que part l’unique route bitumée, qui mène au centre-ville. Pourvoyeur des lacs Faguibine, Télé, Fati et Horo, en eau, le fleuve de Goundam a tari sous l’effet de l’érosion. Et son lit, envahi par des bancs de sable blanc.
Réhabilité, le marché baigne dans l’ambiance. Outre les boutiques, juchées à la grande mosquée, le centre du marché est occupé par des vendeuses de condiments, de poisson séché et de céréales. Juste derrière, les étals des bouchers. A la périphérie, on retrouve les cordonniers et autres tailleurs. Qui discutent avec leurs clients dans un vacarme indescriptible.
Mais dans la vieille ville, les choses n’ont pas beaucoup changé. Dévastés par les inondations, les vieux bâtiments ont fait place à d’autres, plus modernes. C’est, entre autres, le cas de la mairie, de la préfecture ……
Le sable est partout. Il a, presque, englouti certains bâtiments administratifs. Comme le service des Postes. Omniprésents, aussi, les engins à deux roues. De fabrication chinoise, ils sont utilisés pour voyager, transporter des marchandises ou se rendre au champ. On en trouve dans toutes les familles. Oubliés, désormais, les ânes affectés à ces tâches quotidiennes.
Assis sous les hangars, ou prenant leur thé dans les « grins », jeunes et vieux prennent ce changement avec philosophie. « A notre temps, on mettait 2 ou 3 heures de temps pour nous rendre au champ, ou dans les villages environnants. Aujourd’hui, ce n’est qu’une question de minutes », assure un notable de la ville.
Contrairement à certaines villes du nord, ici, les élèves sont en classes. Et les cours se poursuivent. Normalement. A « L’école fondamentale Ibrahim Sidi Touré » où, j’ai effectué mon cycle fondamental, les classes sont délabrées. Dans une classe, que Mme Kadidia Alidji Baby, sa directrice, nous a fait visiter, le plafond menace de s’effondrer. Même mon ancien second cycle, rebaptisé « second cycle Youba Kary Sidibé » (du nom du père de l’ex-Première ministre Mariam Kaïdama Sidibé) est dans le même état. Là aussi, le plafond est dans un piteux état.
Autre menace sur le « second cycle Youba Kary Sidibé » : les crises d’hystérie enregistrées chez les jeunes filles. « Le dernier cas remonte à deux jours. Nous sommes troublés par cette histoire de diable, qui ne s’en prend qu’aux jeunes filles de l’école », déplore un enseignant. Et de poursuivre : « nous avons tout fait, lecture de coran, prières….. mais rien n’y fait ».
[gallery td_gallery_title_input="Ainsi va la vie à Goundam" td_select_gallery_slide="slide" size="full" ids="2285042,2285032,2285022,2285012,2285002,2284992,2284982"]
La vraie cause de l’hystérie des filles au second cycle
L’origine de ces crises d’hystérie a été découverte par Mr Beïdou Baby, un autre enseignant, qui a mené sa petite enquête, en collaboration avec la gendarmerie : « Après plusieurs semaines d’investigations, en collaboration avec les gendarmes, nous avons découvert que ces jeunes filles, victimes d’hystérie, n’étaient pas poursuivie par un quelconque diable, comme elles le laissent entendre ; mais parce qu’elles ingurgitent, avant d’entrer en classe, des produits en sachet censés leur donner un bon teint, ou faire ressortir leurs formes voluptueuses ».
Certes, l’insécurité plane sur la ville. Mais de l’avis même des Goundamiens, ils se disent plus en sécurité que les Bamakois ou les Mopticiens. Les groupes armés, qui ont pris leurs quartiers aux check-points, situés à quelques kilomètres de la ville, veillent au grain. Pour mettre fin aux attaques des bandits, l’entrée et la sortie de la ville sont interdites entre 18 heures et 6 heures du matin. Ici, un hommage mérité doit être rendu aux forces armées et de sécurité, pour leur détermination à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Leurs efforts, conjugués à ceux de la Minusma, ont permis de ramener une certaine quiétude au sein de la population. Vers 17h 30, jeunes filles et garçons prennent d’assaut les terrains de foot de leur quartier.
Trente minutes après, la ville est enveloppée dans un énorme manteau noir. Au loin, les lumières des ampoules scintillent dans l’obscurité ambiante.
La nuit tombe sur Goundam !
Oumar Babi, envoyé spécial

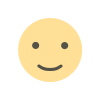 Like
0
Like
0
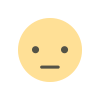 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
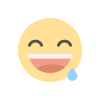 Drôle
0
Drôle
0
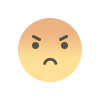 Hmmm
0
Hmmm
0
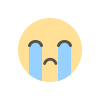 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0


















































