Les divisions internationales sur les manières de réagir (y compris les répercussions politiques, économiques et climatiques) nous ont laissé une planète divisée.
Le sacro-saint « ordre international fondé sur des règles » tant vanté par Washington a subi un test de résistance après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et les toutes dernières informations le précisent : il n’a pas bien résisté. En effet les réactions disparates face à la guerre de Poutine n’ont fait que mettre en évidence les divisions mondiales flagrantes qui reflètent la répartition inégale des richesses et du pouvoir. Ces divisions ont rendu encore plus difficile pour une multitude d’États souverains de trouver le minimum de terrain d’entente nécessaire afin de s’attaquer aux plus grands problèmes mondiaux, notamment le changement climatique.
En fait, il est maintenant raisonnable de se demander s’il existe une communauté internationale reliée par un consensus de normes et de règles, et capable d’agir de concert contre les menaces les plus graves pour l’humanité. Malheureusement, si les réponses à la guerre en Ukraine sont la norme à laquelle nous devons nous référer, les choses semblent mal parties.
Le mythe de l’universalité
Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les États-Unis et leurs alliés se sont empressés de punir cette dernière en la bombardant de sanctions économiques. Ils ont également cherché à susciter un tollé mondial en accusant Poutine de saccager ce que les plus hauts responsables de la politique étrangère du président Biden affectionnent d’appeler l’ordre international fondé sur les règles. Leurs efforts n’ont eu, au mieux, qu’un succès limité.
Oui, un vote écrasant contre la Russie a bel et bien été obtenu à l’Assemblée générale des Nations unies, à savoir la résolution du 2 mars portant sur l’invasion, soutenue par quatre-vingt-dix pays. Cent quarante et une nations ont voté pour et cinq contre, tandis que trente-cinq s’abstenaient. Au-delà de ça, du moins dans « l’hémisphère sud », la réaction face à l’offensive russe a au mieux été peu enthousiaste. Aucun pays clé de cette zone (le Brésil, l’Inde, l’Indonésie et l’Afrique du Sud, pour n’en citer que quatre) n’a même émis de déclaration officielle fustigeant la Russie. Certains, notamment l’Inde et l’Afrique du Sud, ainsi que seize autres pays africains (sans oublier la Chine, même si on pourrait ne pas la compter parmi les pays du Sud), se sont tout simplement abstenus sur cette résolution de l’ONU. Et, tandis que le Brésil (à l’instar de l’Indonésie) a voté oui, il a également condamné des « sanctions arbitraires » contre la Russie.
Aucun de ces pays ne s’est rangé du côté des États-Unis et de la plupart des autres membres de l’OTAN pour imposer des sanctions à la Russie, pas même la Turquie, pourtant membre de l’alliance. En fait, la Turquie, qui a importé l’an dernier 60 milliards de mètres cubes de gaz naturel russe, n’a fait que renforcer sa coopération énergétique avec Moscou, notamment en portant ses acquisitions de pétrole russe à 200 000 barils par jour (plus de deux fois ce qu’elle avait acheté en 2021). Tout comme l’Inde, profitant de prix réduits accordés par une Russie étranglée par les sanctions des USA et de l’OTAN. Il faut garder à l’esprit que, avant la guerre, la Russie ne représentait que 1 % des importations indiennes de pétrole. Début octobre, ce chiffre s’élevait à 21 %. Pire encore, les achats indiens de charbon russe (qui émet bien davantage de dioxyde de carbone dans l’atmosphère que le pétrole et le gaz naturel) pourrait s’accroître de 40 millions de tonnes d’ici 2035, soit cinq fois le volume actuel.
En dépit du risque potentiel de sanctions américaines que fait peser le Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act [CAATSA – loi du Congrès du 2 août 2017 qui renforce les sanctions déjà existantes contre l’Iran, la Corée du Nord et la Russie et qui doit également s’appliquer aux entreprises européennes, NdT], l’Inde s’en est tenue à sa décision première de faire l’acquisition du système russe de défense aérienne le plus sophistiqué, le S-400. L’administration Biden a fini par accorder une dérogation à l’Inde, en partie car elle est considérée comme un partenaire futur majeur contre la Chine, pays qui suscite l’inquiétude croissante de Washington, comme en atteste la nouvelle National Security Strategy. [La stratégie de sécurité nationale est un document préparé périodiquement par la branche exécutive des États-Unis qui énumère les problèmes de sécurité nationale et la manière dont l’administration prévoit d’y faire face, NdT] Toutefois, la préoccupation principale des dirigeants indiens a été de préserver les liens étroits qu’ils entretiennent avec la Russie, guerre ou pas, car ils craignent que cette dernière ne s’aligne davantage avec une Chine qu’ils considèrent comme leur adversaire principal.
Qui plus est, depuis l’invasion, les échanges commerciaux mensuels entre la Chine et la Russie ont en moyenne connu une hausse massive de près de 65 % ; ceux de la Turquie ont quasiment doublé, ceux de l’Inde ont plus que triplé et les exportations russes vers le Brésil ont eux aussi pratiquement doublé. Cet échec des États-Unis à exhorter une grande partie du monde à faire valoir les normes universelles résulte en partie de la colère suscitée par ce qui est vu comme l’arrogance typique des Occidentaux. Le 1er mars, quand vingt pays (dont un certain nombre de membres de l’UE) ont écrit à Imran Khan (alors Premier ministre pakistanais, ayant rencontré Poutine peu après le début de la guerre), l’implorant de soutenir une résolution de l’Assemblée générale réprimandant la Russie, il leur a répondu : « Pour qui nous prenez-vous ? Pour des esclaves… [Considérez-vous comme acquis] que nous ferons tous ce que vous nous direz ? » Une telle demande, a-t-il ajouté, a- t-elle été envoyée à l’Inde ?
De la même façon, Celso Amorim, ministre des Affaires étrangères brésilien pendant sept ans lors de la présidence de Luiz Inácio « Lula » da Silva (il occupera bientôt à nouveau son poste), a déclaré que condamner la Russie équivaudrait à obéir au diktat de Washington. Pour sa part, Lula a affirmé que Joe Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelensky étaient en partie responsables de la guerre, soutenant qu’ils n’avaient pas assez œuvré pour l’éviter ni négocié avec Poutine. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, lui, a mis les actes de Poutine sur le compte de l’expansion provocatrice de l’OTAN vers les frontières russes depuis la chute de l’Union soviétique.
De nombreux autres pays ont simplement préféré ne pas se laisser happer dans une confrontation entre la Russie et l’Occident. Pour eux, leurs chances de faire changer Poutine d’avis étaient quasiment nulles, étant donné leur manque de poids, alors pourquoi s’attirer son mécontentement ? (Après tout, qu’avait à offrir l’Occident pour faire passer cette pilule ?) En outre, au vu de leurs luttes quotidiennes immédiates face aux prix de l’énergie, à la dette, à la sécurité alimentaire, à la pauvreté et au changement climatique, une guerre en Europe semblait une affaire lointaine, une préoccupation nettement secondaire. Le président brésilien Jair Bolsonaro a souvent laissé entendre qu’il n’avait pas l’intention de s’associer au régime de sanctions car l’agriculture de son pays dépendait d’engrais importés de Russie.
Dans l’hémisphère sud, les dirigeants ont également été frappés par le contraste entre le sentiment d’urgence de l’Occident face à la situation ukrainienne et l’absence d’une telle ferveur dès lors qu’il s’agissait de problèmes affectant leur zone géographique. Par exemple, la générosité et la rapidité avec laquelle des pays comme la Pologne et la Hongrie (ainsi que les États-Unis) ont accueilli des réfugiés ukrainiens, tandis que toutes les portes se fermaient pour les réfugiés afghans, irakiens et syriens, ont été largement commentées. En juin, bien qu’il n’ait pas mentionné cet exemple précis, le ministre des Affaires étrangères indiennes Subrahmanyam Jaishankar a mis l’accent sur de tels sentiments quand, répondant à une question portant sur les efforts de l’Union européenne exhortant son pays à durcir le ton avec la Russie, il a fait remarquer qu’il fallait que l’Europe « se défasse de l’idée selon laquelle [ses] problèmes sont aussi ceux du monde entier, mais que l’inverse n’est pas vrai », ajoutant qu’étant donné « le silence singulier » dont avaient fait preuve les pays européens « au sujet de nombreux évènements, notamment en Asie, on pourrait se demander pour quelle raison un pays asiatique pourrait accorder sa confiance à l’Europe pour quelque sujet que ce soit ».
La réaction plus que paresseuse de l’Occident face à deux autres problèmes aggravés par la crise ukrainienne qui a frappé de plein fouet les pays pauvres, a confirmé le point de vue de Jaishankar. Le premier problème portait sur la hausse des prix alimentaires qui vont inéluctablement faire empirer la malnutrition, voire provoquer des famines dans l’hémisphère sud. Déjà en mai, le World Food Program [Programme alimentaire mondial, NdT] prévenait que 47 millions de personnes supplémentaires (davantage que la population globale ukrainienne) étaient sur le point de faire face à une « grave insécurité alimentaire » en raison d’une réduction potentielle des exportations alimentaires russes et ukrainiennes – tout cela en sus des 193 millions de personnes dans 53 pays ayant déjà subi cette épreuve (ou pire) en 2021.
En juillet, un accord négocié entre l’Ukraine et la Russie par les Nations Unies et le président turc Recep Tayyip Erdoğan a effectivement garanti la reprise des exportations alimentaires de ces deux pays (bien que la Russie s’en soit brièvement retirée à la fin du mois d’octobre). Pourtant, seul un cinquième de l’offre supplémentaire est allée en direction des pays pauvres et à faibles revenus. Même si l’ensemble des prix alimentaires a chuté pendant six mois d’affilée, une autre crise ne saurait être exclue tant que la guerre en Ukraine s’éternise.
Le second problème était une augmentation des prix de l’argent emprunté et des remboursements de la dette ayant suivi la hausse des taux d’intérêt par les banques centrales occidentales, qui cherchaient à contenir l’inflation attisée par les pics des prix de l’énergie induits par la guerre. En moyenne, les taux d’intérêt dans les pays pauvres ont bondi de 5,7 % (environ deux fois plus qu’aux USA), ce qui a fait grimper leurs nouveaux emprunts de 10 à 46 %.
Une autre raison plus fondamentale à la lenteur d’une grande partie de l’hémisphère sud à mettre la Russie au pilori, c’est que l’Occident n’a eu de cesse que de jeter aux orties les valeurs mêmes qu’il déclare universelles. En 1999, par exemple, l’OTAN est intervenue au Kosovo, suite à la répression des Kosovars par la Serbie, alors même qu’elle n’était pas autorisée à le faire, comme il est nécessaire, par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies (à laquelle la Chine et la Russie auraient opposé leur véto). Le Conseil de sécurité a bel et bien approuvé l’intervention américaine et européenne de 2011 en Lybie, afin de protéger les civils des forces de sécurité de l’autocrate de ce pays, Mouammar Kadhafi, mais cette campagne s’est toutefois vite transformée en tentative de renversement de son gouvernement quand elle est venue assister l’opposition armée, et a par conséquent été largement critiquée dans l’hémisphère sud pour avoir durablement installé le chaos dans le pays. Après les attentats du 11 septembre, les États-Unis ont avancé des explications légales tout autant tarabiscotées pour soutenir la façon dont la CIA a violé la Convention Against Torture [Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, NdT] et les quatre conventions de Genève de 1949, au nom de l’éradication du terrorisme.
Bien entendu, les droits humains fondamentaux occupent une place proéminente dans le discours que tient Washington sur cet ordre mondial fondé sur les règles, dont la capitale fait si régulièrement la promotion tout en l’ignorant en pratique, notamment au Moyen-Orient tout au cours de ce siècle. L’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine visait à un changement de régime dans un pays qui ne faisait peser aucune menace directe sur la Russie, ce qui constituait effectivement une violation de la Charte des Nations unies ; mais l’invasion de l’Irak par les États-Unis en 2003 tout autant, chose que peu de gens dans l’hémisphère sud ont oubliée.
Guerre et changement climatique
Pire encore, les divisions que l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine a mises en évidence n’ont fait que rendre plus difficile de prendre les décisions audacieuses nécessaires pour affronter le plus grand danger auquel nous faisons tous face : le changement climatique. Même avant la guerre, il n’existait aucun consensus pour désigner qui portait la plus grande responsabilité de ce problème, qui devrait réduire le plus ses émissions de gaz à effet de serre ou qui devrait financer les pays qui ne peuvent tout simplement pas se permettre de faire la transition vers une énergie verte. Peut-être la seule chose sur laquelle tout le monde tombe d’accord en cette période de tension généralisée est-elle que rien de suffisant n’a été effectué pour atteindre l’objectif fixé par l’accord de Paris sur le climat en 2015, qui consistait à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré centigrade. Cette conclusion est pertinente. Selon un rapport des Nations unies publié ce mois-ci, le réchauffement de la planète atteindra 2,4 degrés centigrade à l’horizon 2100. C’est là où en étaient les choses à l’ouverture de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques de 2022, ce mois-ci à Charm-el-Cheikh en Égypte.
Pour commencer, la promesse de 100 milliards de dollars annuels que les pays les plus riches ont faite aux pays pauvres en 2009 pour les aider à s’éloigner d’une énergie basée sur les hydrocarbures, n’a jusqu’ici jamais été honorée, et les versements récents, tout minimes qu’ils furent, se présentaient le plus souvent sous forme de prêts et non de subventions. Les ressources que l’Occident va maintenant devoir consacrer uniquement pour couvrir les dépenses non militaires de l’Ukraine pour 2023 (55 milliards de dollars rien que pour l’assistance budgétaire et la réparation des infrastructures, selon le président Volodymyr Zelensky), associées à une inflation en très forte hausse et à une croissance en berne dans les pays Occidentaux à cause du conflit, font douter que les engagements verts pris envers les pays pauvres seront tenus dans les années à venir. (Sans parler de l’annonce ayant précédé la conférence des Nations unies sur le changement climatique COP26 de novembre 2021, assurant que l’objectif des 100 milliards de dollars serait atteint en 2023.)
Au bout du compte, la forte hausse des prix de l’énergie engendrée par la guerre, en partie car la fourniture de gaz naturel russe à l’Europe a été sabrée, pourrait se révéler être le coup de fouet nécessaire pour que les plus gros émetteurs de dioxyde de carbone et de méthane se tournent plus rapidement vers les énergies solaire et éolienne. Cela semble particulièrement possible en raison de la baisse conséquente du prix des technologies énergétiques propres ces dernières années. Par exemple, le coût des cellules photovoltaïques destinées à la production solaire a baissé de près de 90 % sur la dernière décennie ; celui des accumulateurs lithium-ion, indispensables aux véhicules électriques rechargeables, dans les mêmes proportions depuis 20 ans. L’optimisme quant à un verdissement plus rapide de la planète, refrain désormais ressassé, pourrait se révéler pertinent sur le long terme. Toutefois, quand on en arrive aux progrès à faire sur le changement climatique, les implications immédiates de la guerre ne sont guère encourageantes.
Selon l’Agence internationale de l’énergie, si l’objectif fixé par l’accord de Paris sur le ralentissement du réchauffement climatique mondial, visant des émissions globales égales à « zéro » à l’horizon 2050, doit se révéler atteignable, le développement de toute infrastructure supplémentaire de combustibles fossiles doit cesser sur-le-champ. Et ce n’est guère ce qui se produit depuis le début de la guerre en Ukraine. Au contraire, est survenue ce qu’un expert a désigné sous le nom de « ruée vers l’or des nouvelles infrastructures de combustibles fossiles ». Suite aux réductions radicales des exportations de gaz russe vers l’Europe, la construction d’installations consacrées au gaz naturel liquéfié (GNL) – plus de 20, pour une valeur de plusieurs milliards de dollars – ont été soit planifiées, soit accélérées au Canada, en Allemagne, en Grèce, en Italie et aux Pays-Bas. Le Groupe des sept pourrait même revenir sur sa décision du mois de mai dernier de cesser tout investissement public à l’extérieur dans des projets liés aux combustibles fossiles d’ici la fin de l’année, et son plan pour « décarboner » les secteurs énergétiques des pays membres d’ici 2035 pourrait lui aussi faire long feu.
En juin, l’Allemagne, impatiente de remplacer le gaz naturel russe, a annoncé que des centrales à charbon antédiluviennes, les plus sales des émetteurs de gaz à effet de serre, seraient remises en service. Le Bundesverband der Deutschen Industrie [BDI, Fédération des industries allemandes, NdT] déjà opposé à leur fermeture bien avant le début du conflit, a fait savoir qu’il repassait d’ores et déjà au charbon, de façon que les réservoirs de gaz naturel puissent être remplis avant que le froid de l’hiver s’installe. L’Inde, elle aussi, a réagi à la hausse des prix de l’énergie en présentant des plans visant à accroître sa production de charbon de près de 56 gigawatts d’ici 2032, une augmentation de 25 %. La Grande-Bretagne a jeté aux orties sa décision d’interdire, pour des motifs écologiques, le développement du champ gazier de Jackdaw, dans la mer du Nord, et a déjà signé de nouveaux contrats avec Shell et d’autres entreprises du secteur des combustibles fossiles. Les pays européens, eux, ont conclu plusieurs accords pour des achats de GNL, notamment avec l’Azerbaïdjan, l’Égypte, Israël, les États-Unis et le Qatar (lequel a exigé des contrats sur 20 ans). Puis la Russie a elle aussi réagi aux prix élevés de l’énergie, notamment avec un énorme projet de forage dans l’Arctique visant à faire progresser l’offre mondiale à 100 millions de tonnes de pétrole par an à l’horizon 2035.
Le secrétaire général des Nations unies António Guterres a qualifié cette ruée vers encore plus d’énergie hydrocarbonée de « folie ». Reprenant une expression longtemps réservée à la menace nucléaire, il a laissé entendre qu’une telle dépendance soutenue aux combustibles fossiles pourrait déboucher sur « une destruction mutuelle assurée ». Il n’a pas tort : le rapport 2022 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions du Programme des Nations unies pour l’environnement, publié le mois dernier, concluait que, à la lumière des objectifs d’émissions de tant de pays, le réchauffement de la planète à l’ère de la révolution post-industrielle pourrait aller de 2,1 à 2,9 degrés Celsius d’ici 2100 – bien loin du plus ambitieux 1,5 degré fixé par l’accord de Paris, sur une Terre où la température moyenne a déjà augmenté de 1,2 degré.
Comme le précise le Groupe sur les perspectives climatiques, basé en Allemagne, dans une étude récente, la guerre en Ukraine a également eu des effets directs sur le changement climatique, qui se poursuivront même après la fin des combats. Pour commencer, l’accord de Paris ne contraint pas les pays à déclarer les émissions de leurs forces armées, mais la guerre en Ukraine, conflit susceptible de s’étendre sur le long terme, a déjà énormément contribué aux émissions militaires de carbone, en raison des chars, des avions et de tout le matériel mû par des énergies fossiles. Même les décombres consécutifs aux bombardement des villes ont dégagé encore davantage de dioxyde de carbone – et la reconstruction de l’Ukraine après la guerre, que son Premier ministre a estimé le mois dernier à près de 750 milliards de dollars, ne sera pas en reste. Et cette somme pourrait bien être sous-estimée, vu que l’armée russe a entrepris de tout démolir (à coups de drones, de missiles et de tirs d’artillerie), des centrales électriques et réseaux de distribution d’eau, aux écoles, hôpitaux et immeubles d’habitation.
Quelle communauté internationale ?
Les dirigeants implorent régulièrement la « communauté internationale » d’agir dans un sens ou dans l’autre. Si de telles exhortations doivent se révéler être autre chose que du verbiage, toutefois, il faudra prouver de façon irréfutable que 195 pays peuvent partager des principes de base au sujet du changement climatique – que le monde est plus que la somme des éléments qui le composent. Il faudra aussi prouver que les pays les plus puissants de la planète peuvent mettre assez longtemps de côté leurs intérêts à court terme pour agir de manière concertée et décisive face à des menaces planétaires comme le changement climatique. La guerre en Ukraine n’offre aucune de ces garanties. Malgré toutes les allusions à l’aube nouvelle ayant succédé à la Guerre froide, nous paraissons prisonniers de nos vieilles habitudes – juste au moment où nous avons plus que jamais besoin de changement.
Cet article a été réédité avec l’accord de TomDispatch.
Source :
Responsible Statecraft, Rajan Menon 15-11-2022
Traduit par les lecteurs du site Les-Crises

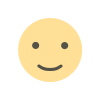 Like
0
Like
0
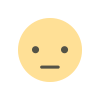 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
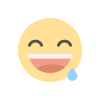 Drôle
0
Drôle
0
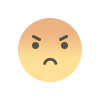 Hmmm
0
Hmmm
0
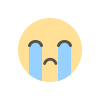 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0












































