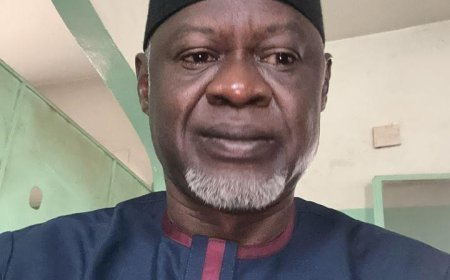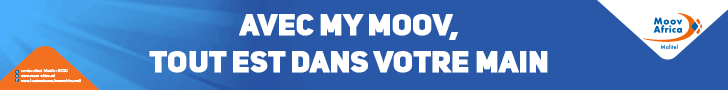Guerre en Ukraine: vers un nouveau «Yalta» favorable à la Russie?
En dressant le bilan de l'année diplomatique écoulée, lors d'une conférence de presse le 14 janvier 2025, le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a affirmé que la problématique «ne repose pas sur l'Ukraine», mais sur l'instrumentalisation de ce pays par les Occidentaux afin «d'affaiblir la Russie dans le contexte de [sa] place dans le système de sécurité eurasien». Le responsable de la diplomatie du Kremlin rappelle qu'une intégration de l'Ukraine dans l'OTAN demeure «un scénario inacceptable pour la Russie» et que Moscou exige également de la part de Kiev le «rétablissement des droits linguistiques et religieux des Russes qui ont été supprimés par la voie législative en Ukraine».
Dans un entretien publié le même jour par le quotidien russe Komsomolskaïa Pravda, Nikolaï Patrouchev, proche et «conseiller» du président Vladimir Poutine, réitère cette exigence et se montre menaçant. «Pour nous, l'enjeu vital reste la protection et le bien-être de nos citoyens et de nos compatriotes à travers le monde», souligne cet ancien directeur du Service fédéral de sécurité (FSB, entre 1999 et 2008), longtemps secrétaire du Conseil de sécurité de Russie (2008-2024) et qui demeure membre titulaire de cet organe stratégique du pouvoir russe. «Il faut absolument mettre un terme aux discriminations que subit la population russe dans plusieurs territoires, à commencer par les pays baltes et la Moldavie», poursuit Nikolaï Patrouchev, qui reproche aux dirigeants de ces pays des «actions irréfléchies» et une «russophobie».
Prenant l'exemple de l'Ukraine, où, selon lui, «le néonazisme et la russophobie ont conduit à l'effondrement du pays», ce fidèle compagnon de Vladimir Poutine «n'exclut pas que la politique antirusse agressive de Chisinau n'aboutisse à l'absorption de la Moldavie par un autre État ou à sa disparition pure et simple». Le conseiller du président russe «n'exclut pas» non plus «qu'au cours de l'année à venir [2025], l'Ukraine cesse purement et simplement d'exister».
Une réécriture de l'histoire par la Russie
Depuis le début de l'agression russe en Ukraine, il y a maintenant près de trois ans en février 2022, l'idée d'une partition de l'Ukraine, qui s'inscrit dans le processus de réhabilitation du pacte germano-soviétique d'août 1939 (ou pacte Ribbentrop-Molotov), a été intégrée dans le discours russe. Le 27 décembre 2024, Vladislav Sourkov, qui fut longtemps «l'éminence grise du Kremlin», appelait de ses vœux «un deuxième partage de l'Ukraine, le premier ayant été légalisé avec succès par les accords de Minsk» (signés en 2014 et 2015 pour mettre fin à la guerre du Donbass). Cette issue serait annonciatrice d'une renaissance des empires selon Vladislav Sourkov, qui mentionnait au passage les déclarations de Donald Trump sur le Canada, le Groenland et le canal de Panama.
Dans un communiqué publié le 29 novembre 2024, le Service de renseignement extérieur russe (SVR) attribuait aux Occidentaux (Roumanie, Pologne, Allemagne et Royaume-Uni) un «plan d'occupation» de l'Ukraine, sous couvert du déploiement d'une force de paix. Dès avril 2022, le directeur du SVR, Sergueï Narychkine, prêtait à la Pologne la volonté de placer sous une tutelle politique et militaire ses «possessions historiques» en Ukraine.
En juillet 2023, Vladimir Poutine lui-même faisait siennes ces accusations, estimant que, «si des troupes polonaises devaient être déployées par exemple à Lviv [dans l'ouest de l'Ukraine, ndlr], elles y resteront pour toujours», affirmation réitérée l'année suivante. Lors d'une réunion avec son Conseil de sécurité, il soulignait que «les territoires occidentaux de la Pologne actuelle sont un cadeau de Staline aux Polonais». En décembre 2023, le président russe jugeait opportun de rappeler qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, Joseph Staline avait «donné» à l'Ukraine des territoires «enlevés» à la Pologne, à la Roumanie et à la Hongrie; des régions que ces capitales, à commencer par Varsovie, souhaiteraient se voir restituer, selon les dires de Vladimir Poutine. C'est pourquoi, affirmait-il, «seule la Russie peut être garante de l'intégrité territoriale de l'Ukraine» (sic).
Quid de la position russe sur des négociations dans le conflit en Ukraine?
L'éventualité d'un gel du conflit sur la ligne de contact actuelle, évoquée par les conseillers de Donald Trump, a été écartée à plusieurs reprises au cours du mois de janvier par les autorités russes, dont les forces continuent de progresser sur le théâtre des opérations russo-ukrainiennes et qui ont enregistré des gains territoriaux, limités mais réels, en 2024. Ainsi, au lendemain de la nouvelle élection du président républicain américain, Sergueï Lavrov a rejeté l'hypothèse d'un arrêt des combats. Il s'agirait, selon lui, d'un retour aux accords de Minsk «dans un nouvel emballage et en pire».
Fin novembre 2024, le SVR estimait qu'«en l'absence évidente de toute possibilité d'infliger à la Russie une défaite stratégique sur le champ de bataille, l'OTAN penche de plus en plus vers la nécessité de geler le conflit ukrainien». D'après le point de vue du SVR russe, un tel scénario aurait pour avantages occidentaux de «restaurer la capacité de combat des forces armées ukrainiennes, de bien préparer Kiev à une tentative de revanche» et de faciliter le rétablissement du complexe militaro-industriel ukrainien.
S'agissant du format des négociations, Nikolaï Patrouchev, dans l'entretien déjà mentionné plus haut, part du principe que des discussions sur l'Ukraine «doivent avoir lieu entre la Russie et les États-Unis, sans la participation d'autres États occidentaux». «Nous n'avons rien à débattre avec Londres et Bruxelles», juge l'ancien secrétaire du Conseil de sécurité russe. «Les dirigeants européens n'ont pas le droit de parler au nom de plusieurs États membres», comme «la Hongrie, la Slovaquie, l'Autriche, la Roumanie et d'autres pays résolus à œuvrer pour la stabilité de l'Europe et à occuper une position équilibrée vis-à-vis de la Russie».
Bien qu'il affirme ne pas poser de préalable à l'ouverture de négociations, Vladimir Poutine les subordonne bel et bien à plusieurs conditions difficilement acceptables par Kiev. Le 19 décembre 2024, lors de sa conférence de presse annuelle, le président russe mettait une fois encore en cause la légitimité du président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le mandat de cinq ans a expiré en mai 2024, observant que «la constitution ukrainienne ne prévoit pas de disposition permettant de prolonger les pouvoirs du président, même en situation de guerre». Volodymyr Zelensky ou quelqu'un d'autre, dit-il, doit recevoir l'onction des urnes pour être accepté comme interlocuteur à Moscou, car «nous ne pourrons signer un texte qu'avec les représentants d'organes légitimes du pouvoir, voilà tout», avertit le président russe.
Sur le fond, Vladimir Poutine rappelle avoir énoncé la position russe en vue de ces négociations, le 14 juin 2024, au cours de son intervention devant les cadres du ministère des Affaires étrangères russe (MID): «Tout y est dit, il n'y a rien à ajouter.» «Nous sommes prêts à engager un dialogue sans aucun condition préalable, a poursuivi le chef du Kremlin en décembre dernier. Mais, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises auparavant, sur la base de ce que nous avions convenu lors du processus de négociations à Istanbul au printemps 2022 et en partant des réalités actuelles sur le terrain.»
Une semaine après le président russe, lors d'une conférence de presse donnée le 26 décembre 2024, Sergueï Lavrov a réitéré la position exposée par lui-même et par les responsables des organes de sécurité (Nikolaï Patrouchev, SVR), selon laquelle «le cessez-le-feu est une impasse». «Il nous faut des accords juridiques définitifs» qui «doivent traiter des causes premières de la crise ukrainienne», en premier lieu «la violation de tous les engagements1 - Contrairement à une thèse répandue, y compris en Occident, il n'y a eu aucun engagement écrit de la part de l'OTAN à ne pas intégrer les pays d'Europe centrale et orientale. Voir notamment le livre «Not One Inch: America, Russia, and the Making of Post-Cold War Stalemate» de l'historienne américaine Mary Elise Sarotte (Yale University Press, 2021). 1 de ne pas élargir l'OTAN vers l'est et l'absorption agressive par l'OTAN de tout l'espace géopolitique allant jusqu'à nos frontières», ainsi que «les actions absolument racistes du régime de Kiev après le coup d'État» (la «révolution de la dignité» de Maïdan en février 2014, ndlr) qui, d'après le ministre russe des Affaires étrangères, cherche à «exterminer tout ce qui est russe» (langue, culture, religion) en Ukraine.
L'épineux affrontement des influences dans la zone
À l'instar de Nikolaï Patrouchev, qui laisse désormais planer le doute sur la pérennité de l'Ukraine, et de ses menaces à l'égard des pays étrangers afin d'assurer «la protection et le bien-être de nos citoyens dans le monde entier», Sergueï Lavrov entretient une semaine plus tard, dans sa conférence de presse du 14 janvier, l'incertitude sur l'avenir de l'Ukraine. Il se déclare prêt à «discuter de l'octroi de garanties de sécurité à ce pays qui s'appelle aujourd'hui l'Ukraine, ou à une partie de ce pays, qui n'a pas encore exercé son droit à l'autodétermination, à la différence de la Crimée, du Donbass et la Nouvelle-Russie» (ou Novorossia, qui prend en compte les deux républiques sécessionnistes de Donetsk et Louhansk, dans l'est de l'Ukraine).
Dans cet entretien, dans lequel il développe une fois encore la thèse selon laquelle les Occidentaux auraient «menti» à la Russie à propos de l'élargissement de l'OTAN vers l'est, il réécrit non seulement l'histoire de l'après-Guerre froide, mais aussi le droit international. En laissant entendre que d'autres référendums conduisant à l'annexion de régions ukrainiennes pourraient être organisés, il se livre à une interprétation extensive et contestable du principe de «l'autodétermination des peuples» et de la Charte des Nations unies pour justifier de nouvelles violations de l'intégrité territoriale d'États souverains.
Ces vues radicales sont partagées par un politiste réputé comme Dmitri Trenine, qui s'est rangé derrière le Kremlin au début de l'invasion russe de février 2022. «L'Ukraine, dans ses frontières du 31 décembre 1991, n'existe plus depuis longtemps», écrit-il pour le magazine hebdomadaire russe Profil. Il est possible, selon lui, que d'autres régions et villes d'Ukraine, comme Odessa (sud-ouest du pays), suivent l'exemple de la Crimée et du Donbass et soient rattachées à la Russie. L'exemple de la chute de Bachar el-Assad en Syrie montre aussi qu'un régime prend des risques en laissant hors de son contrôle des régions dissidentes. La «mission historique» de la Russie consiste, selon Dmitri Trenine, à «libérer toute l'Ukraine du régime antirusse héritier de Stepan Bandera [homme politique nationaliste ukrainien controversé et collaborateur avec l'Allemagne nazie, ndlr], de son idéologie essentiellement néonazie et du poids des influences étrangères, hostiles au monde russe».
Beaucoup d'experts russes se montrent pessimistes sur d'éventuels pourparlers, dans la mesure où l'objet même des négociations fait débat. Pour Washington et Kiev, analyse Vladimir Frolov, expert russe en relations internationales, il s'agit d'identifier les termes d'un règlement entre la Russie et l'Ukraine, tandis que, pour Moscou, le conflit concerne les relations entre la Russie et l'Occident, l'Ukraine n'étant qu'un sujet parmi d'autres. La Russie tente d'obtenir des États-Unis une révision des structures de la sécurité européenne et d'extraire l'Ukraine de la sphère d'influence occidentale, souligne également Andreï Souchentsov, autre expert russe en relations internationales, dans un article pour le groupe de réflexion moscovite Club Valdaï.
Tandis que Donald Trump souhaite une solution rapide, Moscou se prépare à de longues négociations sur un nouvel ordre international. Comme le souligne aussi Vladimir Frolov, les dirigeants russes ne veulent pas d'un accord qui maintiendrait une grande partie de l'Ukraine sur une trajectoire d'intégration dans les structures politico-militaires occidentales, disposant d'une puissante armée et coopérant avec les industries de défense des pays de l'OTAN. L'objectif russe, selon ce même expert russe, c'est «Istanbul+», un accord qui limiterait la souveraineté de l'Ukraine en matière de politique étrangère et de défense et «accorderait à Moscou une influence dominante, incluant la possibilité d'une intervention armée».
Le point d'interrogation Donald Trump
On peut voir dans les propos tenus, ces dernières semaines, par Vladimir Poutine et ses proches l'expression d'une posture de négociation avant le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump et l'ouverture de pourparlers sur le dossier ukrainien. Il reste que les déclarations de Sergueï Lavrov et Nikolaï Patrouchev sont empreintes d'un révisionnisme désormais ouvertement affiché et l'expression d'ambitions impériales assumées. Le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump et les divisions des Européens ont sans doute contribué à cette franchise verbalisée par la Russie.
Contrairement à ce que prétend le ministre russe des Affaires étrangères, qui recourt à une tactique éprouvée des régimes autoritaires pour inverser la réalité, c'est bien la Russie qui utilise l'Ukraine pour tenter de bouleverser l'ordre européen et obtenir la reconnaissance d'une sphère d'influence. De ce point de vue, les propos tenus depuis le début du mois de janvier par Donald Trump, qui évoque le caractère «artificiel» de la frontière avec le Canada et annonce, lors de son discours d'investiture, vouloir «étendre le territoire» des États-Unis, interrogent.
De même, peut inquiéter sa mansuétude à l'égard du refus par la Russie d'une implication de l'OTAN en Ukraine qui, à l'entendre, aurait été «gravé dans le marbre» («written in stone»). Les Européens auraient tout à craindre d'une négociation qui s'engagerait sur ces bases entre Moscou et Washington, même si on peut penser que Donald Trump et ses conseillers redoutent un résultat qui s'apparenterait plus à celui des accords de la conférence de Munich (septembre 1938) qu'aux conclusions de la conférence de Yalta (février 1945).
Source: https://www.slate.fr
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0
20 Juillet 2006 - 00:00
0

 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0