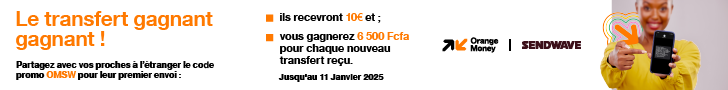“L’Afrique est le dernier continent qui soit encore à la mesure de la France, à sa portée, le seul continent où avec trois cents hommes la France puisse encorechanger le cours de l’histoire “. Cette citation de Louis de Guiringaud, ancien ministre des Affaires étrangères de Valery Giscard d’Estaing, est aussi souvent reprise que l’affirmation selon laquelle “le temps de la France-Afrique est révolu”(François Hollande, discours de Dakar du 12 octobre 2012). Comme tous ses prédécesseurs, François Hollande se sent obligé d’affirmer en début de mandat sa détermination d’en finir avec les pratiques postcoloniales. Comme François Mitterrand, qui limogea fin 1982 le ministre de la coopération initialement chargé demettre en œuvre cette rupture (Jean-Pierre Cot), François Hollande débute son mandat en posant les bases d’une nouvelle relation mais sans modifier l’objectif fondamental d’assurer la continuité de la présence française en Afrique. Comme chez François Mitterrand, la “volonté de renouveler (le) partenariat entre la France et l’Afrique “ (discours de Dakar du 12 octobre 2012) va de pair avec la certitude que “la France ne serait plus tout à fait elle-même aux yeux du monde si elle renonçait à être présente en Afrique” (F. Mitterrand, discours d’ouverture de la XVIIIe conférence des chefs d’État de France et d’Afrique de Biarritz du 8 novembre 1994).
Cette présence en Afrique a certes changé de forme et le temps des accords secrets de défense est révolu. Pourtant, la France s’estime toujours garante de la sécurité des États de son pré-carré et il n’est pas de président de la Ve République qui n’ait été associé à deux ou trois interventions armées dans les anciens territoires de l’Union française. François Hollande est même plus prompt que ses prédécesseurs à intervenir, bien qu’il affirme aujourd’hui vouloir limiterl’aide française au Mali à une simple assistance logistique et matérielle.
Malgré cette prudence, la nature des nouveaux conflits et surtout l’expérience afghane doivent nous inciter à réfléchir aux conditions d’une intervention réussie, conditions qui sont aujourd’hui loin d’être réunies. Non pas, qu’il faille redouter la défaite. Même avec les restrictions budgétaires que nous connaissons aujourd’hui, l’armée française n’a pas à craindre d’être humiliée. Mais, plus insidieusement, parce que les équilibres au sein de la trilogie clausewitzienne (peuple, armée, gouvernement) ont changé et parce que ni la société française ni ses élites politiques ne sont en état de gagner une guerre, ni même capables d’en sortir la tête haute en négociant une paix juste.
Les trois pièges du conflit asymétrique sont déjà posés en territoire malien ; il n’est pas certain que la prudence du chef de l’État suffira à les éviter.
En premier lieu, la guerre est une épreuve de volonté. Or, les deux parties engagées dans ce type de conflit ne sont pas animées du même désir de vaincre. Paradoxalement, l’asymétrie des moyens joue en faveur du plus faible qui bénéficie de l’asymétrie des volontés. Menacé de tout perdre, il est engagé dans une “guerre totale” alors que le plus fort raisonne en termes de “guerre limitée”. Or, “c’est l’adversaire qui fait la loi de l’autre” comme le remarquait Clausewitz dans sa première action réciproque et il s’ensuit que le plus fort, qui redoute avant tout la montée aux extêmes, répugnera à se conformer à cette règle immuable de la guerre qui détermine le vainqueur et le vaincu.
Cette répugnance précipite donc le deuxième piège théorisé par Mao : “la certitude du succès des États forts les pousse à l’escalade pour atteindre les objectifs au risque de se couper des populations ou alors apparaître incompétent”. Puisque le plus faible dicte la loi du plus fort, celui-ci est fatalement entraîné dans une guerre qu’il n’est pas capable de gagner. Pour les armées régulières, la violence doit en effet être encadrée par le droit de la guerre. À l’inverse, les forces irrégulières sont peu économes de leurs propres soldats et se servent de leur population civile à la fois comme d’un bouclier et comme otage. Otage, cette population est soumise au chantage permanent des insurgés qui la terrorisent ; bouclier, elle sert à forcerl’adversaire à la faute. Les arsenaux enterrés sous les écoles comme les postes de commandement placés sur le toit des hôpitaux combinent ainsi les dimensions défensives et offensives en assurant une relative sécurité dans une dialectique meurtrière échappant au jus in bello. Pouvant accepter des pertes insupportables et prendre des risques inconsidérés, les forces rebelles condamnent leurs adversaires à la défensive qui est, au mieux, le moyen de ne pas perdre, mais qui ne donne guère d’assurances de vaincre.
Enfin, les buts de guerre des forces en présence ne sont pas identiques. Comme le constatait Raymond Aron le plus fort “à la volonté de vaincre, le parti rebelle de ne pas se laisser éliminer ou exterminer… Il suffit aux rebelles de ne pas perdremilitairement pour gagner politiquement”. Dès lors s’ouvre une guerre d’usure qui tourne rarement à l’avantage des armées régulières quand, lassées par des expéditions aussi lointaines que coûteuses, les opinions publiques imposeront un retrait sans gloire ni victoire.
Comme l’indiquait l’auteur de “De la guerre”, “on ne saurait introduire un principe modérateur dans la philosophie de la guerre elle-même sans commettre une absurdité. Les auteurs des “horreurs actuelles” (discours de Dakar du 12 octobre) et autres rebelles, terroristes et insurgés, pirates et bandits (des appellations empruntées au vocabulaire colonial) auront à cœur de démontrer soit l’inhumanité soit l’irrésolution de leurs adversaires. Entre ces deux maux, nous ne pouvons aujourd’hui que choisir le second (l’absurdité de Clausewitz), ce qui n’est pas de bon augure pour notre nouvel engagement en Afrique subsaharienne.
Jean-Jacques Roche, professeur de relations internationales à Paris II et directeur de l’ISAD
Le Monde.fr | 17.10.2012 à 10h27