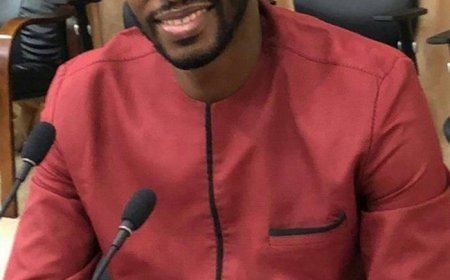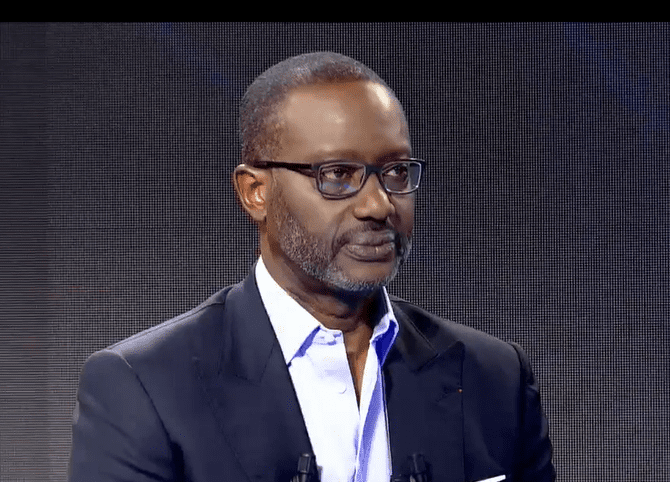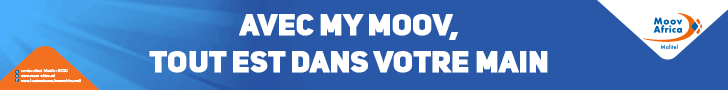C’est une enquête transfrontalière réalisée par des journalistes malien, burkinabé et nigérien en septembre 2023 avec l’appui de la Norbert Zongo pour le journalisme d’investigation en Afrique de l’Ouest (CENOZO) qui met en exergue des difficultés de tout genre dans la gestion des cantines scolaire. Au regard de leur l’importance dans le maintien des enfants dans certaines régions du Mali, du Burkina Faso et du Niger, nous avons décidé de publier cette enquête.
Dans les pays du Sahel, le maintien des élèves dans les écoles constitue un défi dans les zones rurales. Le programme des cantines scolaires constitue une réponse à ce problème et participe à la sécurité alimentaire des enfants.
Mais du Mali au Niger en passant par le Burkina Faso, ce programme est confronté à de nombreuses irrégularités administratives et organisationnelles qui impactent le taux de scolarisation des enfants, déjà mis à rude épreuve avec la fermeture de milliers d’écoles de la région en raison de la situation sécuritaire liée aux attaques des groupes armés.
Dans le cadre du Programme d’appui à l’inclusion scolaire (PAIS) au Mali, environ «
14 millions de repas ont été distribués dans près de 187 écoles/cantines scolaires entre octobre 2018 et juin 2022 », soit environ 48 000 écoliers bénéficiaires au cours des quatre dernières années.
Au Niger, entre 2019 et 2020, le Programme alimentaire mondial (PAM) a aidé plus de 127.000 enfants dans 820 écoles à travers les cantines scolaires.
Sur la période 2023-2025, le programme intégré de soutien à l’alimentation et à la nutrition scolaires, lancé en soutien à l’Initiative présidentielle “
Assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour“, vise à toucher au Burkina Faso 108.137 enfants issus de 476 établissements (préscolaires et primaires), 2.237 enseignants et 15.420 ménages ruraux vulnérables dans huit communes du pays.
Mécanisme de scolarisation des enfants défavorisés
Au Niger comme dans plusieurs pays ouest-africains, plusieurs obstacles empêchent la poursuite de la scolarité des apprenants. Parmi ces difficultés figure la pauvreté des parents.
Selon la Banque mondiale, 40% de la population vit sous le seuil de la pauvreté au Sahel. «
Faute de moyens financiers, beaucoup de parents préfèrent garder leurs enfants à la maison. Ils les assistent dans les travaux champêtres et autres. Mais les écoles dotées de cantine permettent aux enfants de rester à l’école puisqu’ils bénéficient des repas journaliers. Ils mangent à l’école et cela facilite la fréquentation », explique Habou Brah, enseignant.
Son collègue Abdou Issa relève la nécessité de créer partout où besoin les cantines scolaires : «
En plus du fait qu’elle encourage les élèves à venir à l’école… les enfants sont dans de meilleures conditions d’apprentissage ». « Mes enfants, poursuit-il, passent plus de temps à l’école avec leurs camarades qu’à la maison. Du fait que les élèves mangent ensemble, cela crée une certaine cohésion et solidarité entre eux », constate le parent d’élève Laouali Rabiou.
Pour Salif Kanfo de l’ONG Karkara, «
la satisfaction des élèves se lit lors de la récréation où ils reçoivent un petit déjeuner et à la descente pour le déjeuner. Par ce fait, les enfants suivent les cours normalement dans les classes et dépendent de moins en moins des parents qui sont pour la plupart vulnérables. Ce repas est une source de motivation pour la fréquentation scolaire et, de façon générale, incite les enfants du village à plus fréquenter l’école ».
Le revers de la médaille
Si le programme des cantines scolaires vise à encourager la scolarisation des enfants vulnérables en milieu rural, force est de reconnaître les effets inverses des difficultés liées à sa mise en œuvre. En cas de rupture de stock, certains élèves refusent d’aller à l’école, jusqu’au prochain ravitaillement, quel que soit le temps que cela puisse prendre.
Au Burkina Faso, certains élèves se voient contraints d’abandonner les classes pour prendre en otage les arbres de raisins sauvages, afin de trouver de quoi calmer la faim.
«
Certains parents donnent un morceau de tô (pâte de maïs en langue locale Mooré – NDLR)
à leurs enfants en guise de repas de la journée, mais à une certaine période, ils économisent leurs vivres en prévision des prochains travaux champêtres. Et là, les enfants arrivent le matin avec ce qu’ils ont mangé la veille au dîner dans le ventre », confie Edmond Kabré, enseignant à l’école Absouya B dans la région du Plateau central.
Et pourtant, dans le cadre du programme de cantines, le gouvernement du Burkina transfère, depuis 2017, plus de 18 milliards de Fcfa aux communes afin de garantir chaque année au moins un repas par jour à chaque élève burkinabè.
Au Mali, la loi fixant le régime de l’alimentation scolaire stipule dans son article 2 que «
l’alimentation scolaire doit contribuer à l’égalité des chances et au bien-être des enfants ». La loi n°98-12 du 1er juin 1998, portant orientation du système éducatif au Niger, comporte des dispositions qui maintiennent les enfants à l’école jusqu’à l’âge de 16 ans. Mais ces nobles engagements sont soumis aux aléas dans sa concrétisation.
Des irrégularités dans l’approvisionnement des cantines scolaires
Au Mali, le système des cantines scolaires est confronté à plusieurs défis. Dans le pays, seuls 62% des cantines scolaires sont fonctionnels, selon le rapport final du Groupe de Suivi Budgétaire 2023.
Pour Maman Kamaté, point focal de la cantine scolaire du Centre d’Animation Pédagogique (CAP) de Kalaban Coro, le programme des cantines scolaires «
est mis en œuvre de manière irrégulière » pendant l’année scolaire 2022-2023. Il évoque également des difficultés liées à l’approvisionnement en denrées alimentaires en raison de l’absence de dotation de fonds pour l’approvisionnement.
À Ouelessebougou dans la nouvelle région de Bougouni (Mali), les responsables d’écoles, notamment de Dialakoro, de Djitoumou et de Nkorobougou, disent n’avoir rien reçu comme fonds alloués à leur cantine scolaire au cours de l’année scolaire 2022-2023. «
Depuis 2016 jusqu’à nos jours (…) nous ne sommes plus approvisionnés en denrées alimentaires de manière régulière. Pour 110 élèves, elle (la mairie–NDLR)
nous propose souvent deux sacs de riz pour toute l’année. C’est même le cas cette année, alors que le budget a évolué entretemps, de 600 000 à plus de 2 millions de Fcfa », témoigne Issa Coulibaly, Directeur d’école fondamentale dans le village de Nkorobougou.
Au Burkina Faso, la Direction générale de l’allocation des moyens spécifiques aux structures éducatives (DAMSSE), structure technique en charge des cantines scolaires, relevant de la Direction générale de l’accès à l’éducation formelle du ministère de l’Éducation nationale ; constate que, de façon générale, les communes rencontrent des difficultés pour acquérir les provisions au profit des structures éducatives. Ces difficultés se traduisent par des retards dans l’acheminement des vivres.
La structure pointe du doigt la négligence des mairies, pendant que celles-ci se plaignent de la difficulté à obtenir le quitus du contrôleur financier puis le contrôle de la qualité des vivres. «
En fait, je me demande si les gens comprennent ce que veut dire le transfert des compétences et l’importance de l’éducation. Est-ce qu’ils comprennent que l’éducation est une priorité pour l’Etat. Est-ce qu’ils savent que c’est l’avenir de leurs enfants qui est en jeu ? » s’insurge Brama Sessouma, premier responsable de la DAMSSE.
Parmi les anciens maires burkinabè, seul Mathieu Baré Compaoré (maire de la commune de Guiba de juillet 2017 à septembre 2021), a accepté de se prononcer sur la question. Il est catégorique : «
le contrôle constitue l’obstacle majeur à la réalisation de tout le processus visant à assurer un repas aux élèves dans les écoles ». Il se rappelle qu’après avoir acquis des vivres en novembre 2019, c’est en juillet 2020 que ceux-ci ont pu être répartis entre les écoles de la commune de Guiba.
« Ça se passe entre le fournisseur et le contrôleur. Le maire assiste impuissant. Ils nous avaient parlé en son temps de taux de brisure et de haricot non fumigé. Nous sommes d’accord que l’on rejette des vivres pourris, mais s’agripper à des détails techniques pendant que les enfants ont faim, c’est un peu abusé », fulmine Mathieu Baré qui dénonce «
la mauvaise foi des agents commis au contrôle de la qualité des vivres et les lourdeurs de la chaîne financière ».
« D’année en année, des difficultés surgissent. Nous constatons des problèmes dans le processus d’attribution des marchés. Il arrive qu’un marché soit attribué à un prestataire qui n’a pas la capacité financière. La qualité des provisions est cruciale pour le ministère et nous assurons un contrôle physico-chimique en recrutant des prestataires. Parfois, le contrôle recommande que des provisions soient rejetées ou changées, ce qui contribue parfois à retarder le processus d’approvisionnement des écoles », explique Brama Sessouma, premier responsable de la DAMSSE.
Au Niger, pour permettre la disponibilité des produits et promouvoir la production locale, le PAM a institué deux mécanismes de ravitaillement des établissements scolaires en vivres. Certaines écoles sont payées en cash, via les établissements financiers (Niger Poste et autres), d’autres sont ravitaillées en vivres directement par les fournisseurs du PAM.
Les achats se font au niveau de la communauté. «
L’achat local de mil et sorgho permet de servir aux écoliers les aliments de leur propre milieu, d’améliorer les revenus des petits producteurs et de booster leur production » remarque Tassiou Issa, un habitant de Dogo.
«
Au niveau de chaque école, il y a un registre où le directeur note la dotation. Elle est faite par trimestre. Le PAM amène du sorgho, de l’huile, du sel et du mil. L’Etat assure de son côté les condiments », explique Habou Brah, Enseignant de carrière ayant servi à l’école Dan Ballou dans la commune rurale de Dogo.
Par rapport à la gestion de vivres, il indique que «
le stock est confié au directeur de l’école en présence des membres du Comité de gestion dont le président. Chaque jour, il est tenu d’écrire la situation au niveau des registres ».
Mais la gestion du stock entraîne des conflits entre les acteurs locaux impliqués, notamment entre le Directeur d’école et les membres du Comité de gestion ou entre les membres des Comités de gestion et les populations qui soupçonnent des cas de détournement et de mauvaise gestion. Aussi, l’affectation des enseignants dans une école dotée de cantine constitue un privilège, ce qui laisse planer le doute sur la gestion transparente des dotations des cantines scolaires au Niger.
Des coupes budgétaires après le coup d’Etat au Mali
Dans son dernier rapport, le Groupe de suivi budgétaire (GSB) – un regroupement d’ONG et d’association créé en 2007 – stipule qu’il n’y a pas eu la création de nouvelles cantines scolaires au Mali pour le compte de l’année académique 2021-2022. «
Le nombre de cantines scolaires de l’année académique 2020/2021 a été reconduit, soit un total de 1 574. Sur ce total, les équipes du GSB ont observé que 980 étaient fonctionnelles contre 594 cantines non fonctionnelles pour un total de 364 599 élevés, selon les données d’enquête », indique le rapport.
Au cours d’un entretien qu’il nous a accordé, le Directeur général adjoint du Centre national des cantines scolaires (CNCS), Nouhoum Doumbia, a souligné que des mesures sont prises pour garantir la sécurité alimentaire dans les cantines scolaires à travers le pays. Cependant, il a admis que des problèmes subsistent notamment en raison de la réduction du budget de fonctionnement de l’État après le coup d’Etat du 18 août 2020.
Selon M. Nouhoum Doumbia, le budget d’Etat consacrait 100 Fcfa par jour et par élève. Le reste est complété par la communauté locale (condiments, bois de chauffe et cuisine). Chaque année, l’Etat faisait progresser cette subvention de 10% du nombre de cantines. Mais après le coup d’Etat, cela n’est plus d’actualité. «
Les budgets sont un peu réduits partout », regrette-t-il. Pour remédier à la situation, M. Nouhoum Doumbia estime qu’il faut «
organiser les communautés de sorte qu’elles puissent produire pour alimenter les cantines scolaires au-delà du maigre montant que l’Etat met à disposition ».
Conflit de compétences au Burkina Faso
Puisqu’il est admis, selon un dicton bien connu, que « ventre creux n’a point d’oreille », il est nécessaire de trouver des solutions pour assurer le fonctionnement des cantines afin de servir des vivres de bonne qualité aux élèves. Le 17 juin 2021, le gouvernement burkinabè a lancé l’«
Initiative Présidentielle » qui vise à «
mettre fin à la malnutrition des enfants, surtout ceux en âge scolaire ».
L’initiative repose sur plusieurs piliers dont l’amélioration de la disponibilité des denrées alimentaires par un approvisionnement optimal des cantines scolaires, l’amélioration de la valeur nutritionnelle des menus des cantines scolaires ; la couverture des besoins de santé et l’amélioration des revenus des ménages en état de précarité alimentaire.
Deux ans après, la Secrétaire permanente de l’IP (Initiative Présidentielle) se réjouit des acquis engrangés. « L’engagement politique est le premier acquis. Je voudrais souligner que lorsqu’il y a deux ans, on lançait l’initiative dans l’école de Lemnogo, le taux de réussite était de 30%. Une année après, il est passé à 65%. Cette année (2023) le taux de réussite est de 100%. Pour peu que les acteurs fédèrent leurs énergies, on peut former des élites dans ce pays », a-t-elle relevé.
Même si les prouesses de l’IP sont saluées, le rôle de la structure ne fait pas l’unanimité dans le débat public. Le responsable de la DAMSSE, Brama Sessouma, dénonce un conflit de compétence sur le terrain entre le ministère de l’Education nationale et le Secrétariat permanent de l’IP.
« Ce dont on aurait besoin, ce sont des actions pour rallonger le fonctionnement de la cantine et surtout prendre en charge les enfants qui ne sont pas à l’école, alors que pour le moment l’IP apparaît plutôt comme un doublon. Nous pensons que le SP/IP devrait revoir sa copie pour rester une structure d’accompagnement des acteurs qui interviennent pour l’alimentation scolaire », préconise Brama Sessouma.
«
J’ai l’impression que le rôle du SP/IP est de capter les partenaires traditionnels pour les cantines et leur dire de passer désormais par lui. L’acteur principal pour l’opérationnalisation des cantines, c’est bien le ministère de l’Éducation nationale », explique Brama Sessouma.
Nécessité de consolider l’implication des acteurs
Dans la région du Sahel, il est essentiel de renforcer la coordination entre les différents acteurs impliqués et de mettre en place des mesures visant à assurer la sécurité alimentaire des apprenants, afin de garantir leur santé et leur bien-être.
Pour Guimba Traoré, président du Comité de gestion scolaire (CGS) de Deguela dans la commune de Kangaba (Mali), la nécessité d’une collaboration étroite entre l’Etat et les autorités locales est primordiale pour résoudre les problèmes liés à l’approvisionnement des cantines scolaires.
Kamory Keita, Maire chargé de l’éducation du cercle de Kangaba et représentant de la collectivité, pour sa part, a indiqué qu’il n’y a pas de problème majeur pour faire fonctionner les cantines scolaires, à l’exception de la «
non-implication des communautés à hauteur souhaitée ». Au Niger, certains Comités de gestion qui sont censés faire un travail de sensibilisation et de conscientisation dans les communautés restent inactifs. Certains membres de ces comités sont désignés grâce à leur influence au niveau local, ce qui explique l’incapacité des comités à jouer pleinement leur rôle.
En attendant que les différents acteurs accordent leurs violons, les parents d’élèves pourraient eux-mêmes s’impliquer pour lancer des cantines endogènes sur la base de cotisations soit de vivres, soit en cultivant ensemble un champ pour l’école. Cette dernière option n’est d’ailleurs pas nouvelle, il suffirait de la remettre au goût du jour pour améliorer les conditions d’apprentissage des élèves dans la région du Sahel.
www.cenozo.org
Enquête réalisée par Nadège YE (Burkina Faso), Lin dit Moussa DIALLO (Mali), Souleymane BRAH (Niger), avec l’appui de la Cellule Norbert Zongo pour le journalisme d’investigation en Afrique de l’Ouest (CENOZO).
NB : le chapeau est de la Rédaction.

 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0