
Le choc de l’image, le poids du langage. Deux reportages télévisés retransmis la semaine dernière par des chaînes d’information internationales illustraient de manière dramatique toutes les difficultés à combattre le virus Ebola dans la sous-région ouest-africaine. Dans le premier élément, un chef de famille sierra-léonais expliquait pourquoi il avait choisi l’automédication lorsqu’il avait piqué une très forte fièvre qui pouvait s’assimiler à un symptôme précurseur de la fièvre hémorragique. Certain de n’avoir contracté qu’une forme compliquée de paludisme, l’homme s’était mis en quarantaine dans sa propre maison et s’était « auto administré » le traitement qu’il jugeait idoine et qui effectivement l’a guéri. Le patient indiquait avoir eu deux bonnes raisons de ne pas aller à l’hôpital. Primo, on l’y aurait sans autre forme de procès enfermé avec les cas suspects et il aurait donc eu toutes les chances de contracter le virus. Secundo, il avait perdu le peu de confiance qu’il avait en le personnel soignant en apprenant la mort du médecin responsable de la lutte contre l’épidémie en Sierra Léone.
Le second élément rapportait, lui, une déclaration désemparée de la présidente libérienne demandant pardon à ses compatriotes pour le faible équipement des structures médicales nationales. Elle se désolait qu’il n’y ait même pas assez d’ambulances pour aller chercher les malades et qu’il fallait utiliser des pick-up pour le faire. Les propos du citoyen lambda sierra-léonais et l’aveu de Mme Johnson Sirleaf confirmaient une situation connue de tous et que Barack Obama a très lucidement analysé au sommet Etats Unis-Afrique de la semaine dernière. Le président américain avait fait remarquer que de par son mode de transmission, la maladie pouvait être contenue avec une relative facilité. Mais à deux conditions : disposer d’un système de santé robuste et bénéficier de relations de confiance entre les populations et le corps médical.
Le second facteur est, à notre avis, encore plus déterminant que le premier. Les spécialistes mettent tous en évidence l’élément « compliquant » que constitue le triple refus des populations : refus de renoncer à des habitudes de consommation devenues aujourd’hui à risques ; refus d’abandonner les rites funéraires qui malheureusement favorisent la contagion ; et surtout refus par beaucoup de prendre en compte les messages officiels et d’admettre la réalité d’un mal qui n’avait jamais sévi sous ces latitudes. Cette triple résistance des populations explique en grande partie la rapidité de la propagation du mal, rapidité qui a étonné les autorités sanitaires mondiales qu’on ne pourrait pourtant pas accuser d’avoir manqué de vigilance.
LE VERRE À MOITIÉ PLEIN. L’épidémie Ebola met donc en évidence une réalité bien africaine, la juxtaposition dans de nombreux pays de deux univers qui cohabitent sans forcément interagir. D’un côté, l’Etat qui s’acquitte tant bien que mal de ses obligations d’appui et de soutien aux citoyens ; et de l’autre, le pays réel qui s’organise pour subsister en limitant son recours au pays officiel. En période « normale », la cohabitation fonctionne sans trop d’à-coups. Mais en temps de crise ou en cas de catastrophe, le mécanisme se dérègle complètement sous l’effet cumulé de l’impuissance constatée des citoyens à faire face seuls à la situation et de la difficulté de l’Etat à prendre totalement en charge une fonction protectrice et salvatrice qu’il n’a exercée jusqu’alors qu’épisodiquement. L’Organisation mondiale de la santé qui a mesuré la brutale aggravation de la situation a donc eu la réaction idoine en décrétant « l’urgence de santé publique de portée mondiale ».
En réalité, son action a moins pour objectif d’empêcher une contamination à l’échelle de la planète que de juguler une propagation intra-africaine. Car ainsi que l’a fait remarquer le président américain, les pays développés ont les moyens de contenir la maladie dès l’apparition des premiers cas et travaillent déjà sur un vaccin anti Ebola. Par contre, sans un appui conséquent en spécialistes et en équipements, notre continent ne réduira pas sa vulnérabilité à l’épidémie. Face à la faiblesse des moyens de lutte, décréter l’état d’urgence comme l’ont fait le Libéria et le Nigéria relève plus de l’annonce symbolique que de l’instauration d’un dispositif efficace.
L’irruption de l’aggravation de l’épidémie Ebola dans l’agenda du sommet Etats unis-Afrique souligne bien les avancées et les limites de notre continent en ce début de XXIème siècle. Ceux qui veulent voir le verre à moitié plein s’appuient sur un taux de croissance supérieur à 5% au cours de la décennie écoulée, sur une démocratisation politique certes à vitesse variable, mais présente dans la plupart des Etats et sur une attractivité encore balbutiante, mais déjà perceptible auprès des investisseurs extérieurs. Pour les optimistes, la preuve du gain de considération dont bénéficie notre continent est administrée par l’organisation du sommet de Washington. Lequel représente la volonté de l’Amérique d’être plus présente sur un continent où la Chine est désormais solidement implantée et où les Européens s’emploient à blinder les positions qu’ils ont préservées. Cette interprétation de l’événement n’est pas fausse, mais elle doit être acceptée sans céder à de douces illusions. Deux constats sont en effet à garder à l’esprit. D’une part, les Etats unis ne peuvent se satisfaire du fait que seulement 1% de leurs exportations se fasse en direction de notre continent. Tout comme ils acceptent mal de se faire aussi nettement distancer par la Chine (deuxième partenaire économique de l’Afrique après l’Union européenne), le volume des échanges commerciaux sino-africains atteignant en 2013 210 milliards de dollars alors que celui des transactions américano-africaines plafonnait à 85 milliards.
D’autre part, les Etats-Unis, prioritairement tournés vers l’Amérique latine, mais surtout vers la zone Asie-Pacifique, ne sont pas près de réorienter radicalement leurs choix préférentiels. Ils sont donc disposés à un effort significatif (représenté par les 33 milliards de dollars d’investissement annoncés dont 14 sont déjà programmés par certaines grandes firmes) pour rattraper partiellement leur retard africain, mais ne sont pas allés jusqu’à une mise exceptionnelle (les 7 milliards de garantie apportés par l’Etat restent relativement modestes).
LE RÔLE DES FORTES PERSONNALITÉS. Le sommet de Washington est donc révolutionnaire dans sa forme puisqu’il constitue la première rencontre d’un président américain avec ses homologues africains et qu’il est destiné à s’institutionnaliser. Mais il reste prudent dans son volet économique. A l’image de certaines grandes firmes américaines. Ces dernières qui avaient choisi la politique du moindre risque pendant la crise financière lancent aujourd’hui des coups de sonde en direction de ce qui est pour la plupart d’entre elles une terra incognita, un territoire mal connu.
Le sommet a aussi confirmé que les Américains ont bien pris la température d’un monde africain qui change. Sur le plan de la gouvernance et du respect de l’Etat de droit, ils le font avec cette combinaison de pragmatisme et de fidélité aux principes qui ne semble n’appartenir qu’à eux. Ils ont écarté sans états d’âme les pays qu’ils ont considéré comme indésirables, c’est-à-dire l’Érythrée, la Centrafrique, le Soudan et le Zimbabwé. Mais ils sont restés imperturbables face à la pression des organisations spécialisées dans la défense des droits de l’homme qui avaient souhaité que la mesure de mise à l’écart soit étendue à d’autres chefs d’Etat. Ils ont aménagé un espace d’échanges où s’est exprimée sans tabou la société civile africaine, mais n’ont pas ouvert à cette dernière l’accès aux questions de sécurité et de gouvernance qui se sont discutées en huis clos par les chefs d’Etat. Ils ont exprimé en termes très nets leur opposition à toute tentative de modification des Lois fondamentales africaines, mais se sont bien gardés de faire publiquement la leçon aux chefs d’Etat à qui un tel projet est prêté.
Ces derniers l’auraient-ils accepté ? Nous ne le pensons pas. Ainsi que l’a fait savoir implicitement le président égyptien qui n’a pas fait le déplacement à Washington. Abdel Fattah Al Sissi avait peu apprécié les remarques critiques américaines sur ses opérations de neutralisation des Frères musulmans. Autre indice, rien n’a filtré des entretiens que le secrétaire d’Etat Kerry a eus avec les présidents du Burundi, de la RD Congo et du Burkina Faso. Ce qui n’a pas empêché le porte-parole du gouvernement congolais de remettre brutalement à sa place l’envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies dans la région des Grands lacs lorsque celui-ci avait affirmé qu’une éventuelle révision constitutionnelle aurait été « déconseillée » par les USA à Joseph Kabila. Ce qui n’a pas empêché le président Blaise Compaoré de prendre le contrepied de précédentes déclarations de Barack Obama et de souligner le rôle joué dans la vie d’une nation par les « fortes personnalités », surtout en des périodes critiques. Le chef de l’Etat Burkinabé a tout aussi fermement défendu la liberté de chaque peuple à choisir le cheminement démocratique qui lui convenait.
Ces prises de position témoignent de la montée de sensibilités nouvelles en Afrique. Le temps des primes à la démocratie est passé sans que ceux qui s’étaient efforcés de jouer aux très bons élèves aient bénéficié de retombées durables. L’époque est désormais aux réajustements, ou plutôt aux rectifications revêtues d’un sommaire habillage juridique. Par une étrange ironie de l’Histoire, la nouvelle tendance a sans doute été portée par un deuxième vent d’Est venu cette fois-ci de Russie où la double permutation chef de l’État – Premier ministre a démontré qu’il était possible d’accommoder la Constitution à un projet politique. En Afrique, la diversification des possibilités de coopération, notamment avec la Chine et les puissances émergentes, ont rendu bien des autorités allergiques à un certain type de remontrances. Ces autorités sont d’autant moins disposées à écouter les mises en garde du Nord que la conjoncture a notablement affaibli la portée des ultimatums naguère péremptoires. Les Etats-Unis ont donc pris acte de cette évolution et n’exercent le principe de sévérité absolue qu’à l’encontre des auteurs de coups d’Etat. Avec même une notable exception faite récemment en faveur de l’Egypte.
NI ABSENTS, NI INDIFFÉRENTS. Pour des pays comme le Mali, le signal le plus réconfortant délivré par le sommet de Washington est certainement celui d’une implication plus marquée de l’Amérique dans le traitement des problèmes de sécurité en Afrique. L’exemple de l’Irak et de la Syrie est pour démontrer l’imprévisibilité que peuvent revêtir la montée en puissance de combattants djihadistes et la fragilité des armées nationales face à ces ennemis même lorsque (comme cela a été le cas en Irak) elles ont été restaurées sans regarder à la dépense. Les aides qui vont être consenties par Washington s’efforceront de bloquer l’éventualité de scénarios catastrophes en Afrique. Tout d’abord par l’appui à la création d’une force d’intervention rapide dont les premiers contingents seraient fournis par des pays disposant d’une réelle expérience dans les opérations de maintien de la paix. Soit le Ghana, l’Ethiopie, le Sénégal, la Tanzanie, le Rwanda et l’Ouganda. Ensuite, par un nouveau plan d’aide aux pays exposés au risque de déstabilisation par des entités terroristes (Kenya, Mali, Niger, Nigéria, Tunisie et Ghana).
Souligner les acquis du sommet de Washington ne doit pas faire oublier que les Etats-Unis n’ont jamais été absents du continent africain, ni indifférents à l’égard de celui-ci. En témoignent des programmes comme l’African growth and opportunity (AGOA), le Millenium challenge corporation, le Power Africa ou encore la participation à des initiatives comme Feed the future en faveur de petits exploitants agricoles. Aujourd’hui, la nouveauté est surtout que l’Amérique manifeste de manière tout à la fois évidente et mesurée sa volonté de se mettre un peu plus à l’heure africaine.
Il reste maintenant à savoir si notre continent pourra répondre de manière idoine aux propositions de Washington qui comme d’autres partenaires avant lui avaient fait le pari d’une « Afrique demain prospère ». Il nous faut dans cette perspective nous acquitter d’une double nécessité : définir à qui profitera la prospérité à venir et indiquer ce qu’apporteront les Africains en vision et en compétences pour que le renforcement des relations se fasse dans une logique « gagnant-gagnant ». Obama avait eu dans son discours de la semaine dernière cette formule ciselée : « l’Afrique, aussi convoitée qu’elle semble l’être aujourd’hui, n’est utile au monde que forte et autonome ». Un fils du continent aurait-il dit mieux ?
G. DRABO







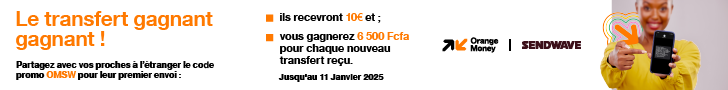


L’ avenir politique du Mali est sombre.
Le cancer qui ronge le mali aujourd’hui et qui bloque son devenir c’ est la mauvaise qualité des hommes qui le gouverne.
Les politiciens sont véreux et n’ont pas l’ amour du pays. Ils ne se soucient que de leur ascension sociale et économique personnelle.
Les cadres sont médiocres, ils sont les prostitués des politiciens.
Le Mali est en manque de leader.
ATTENDONS QUE DIEU NOUS OFFRE LA THERAEPIE NECESSAIRE
AMEN!
Comments are closed.