Goonga TANk : Kabylie, Azawad et les leçons de souveraineté
Depuis plusieurs décennies, la question du séparatisme constitue un nœud de tensions majeures dans le Maghreb et le Sahel. En Algérie, la Kabylie demeure une région où s'exprime un sentiment d'isolement historique, souvent réprimé.

Au Mali, le dossier touareg (appelé à tort "cause de l'Azawad") a été instrumentalisé à diverses périodes, notamment par des puissances régionales comme l'Algérie. Cette même Algérie qui, aujourd'hui, Dieu ne dormant pas, s'offusque des revendications kabyles, s'est longtemps montrée complaisante vis-à-vis des velléités séparatistes au nord du Mali.
Cette contradiction géopolitique n'a pas échappé à Bamako, et elle cristallise les tensions croissantes entre les deux pays. Il faut noter que pour l'Algérie, le problème de souveraineté a toujours été à géométrie variable, selon qu'il s'agisse du nord-Mali, du Sahara marocain ou de la Kabylie algérienne. À cet effet, lorsque les autorités algériennes s'insurgent contre les demandes d'autonomie de la Kabylie, elles brandissent la souveraineté nationale comme un principe sacré. À juste titre, car l'intégrité territoriale d'un État ne peut être morcelée au gré des revendications identitaires. Mais cette même souveraineté semble soudainement relative lorsque l'Algérie accueille, soutient ou donne une tribune internationale aux leaders séparatistes touareg, qu'elle légitime sous l'étiquette flatteuse de "Front de libération de l'Azawad". Ces deux poids, deux mesures ne sont ni plus ni moins qu'une ingérence. D'autant plus insupportable que le Mali est un pays souverain qui a le droit d'évaluer, de réviser, voire de rejeter des accords qui ne servent plus ses intérêts.
L'accord d'Alger de 2015, s'il avait suscité quelques espoirs au départ, a depuis révélé ses limites. Mal conçu, imparfait dans sa rédaction, il s'est progressivement mué en piège diplomatique, offrant une reconnaissance excessive à des groupes armés dont plusieurs éléments ont ensuite glissé vers le djihadisme.
La Kabylie et l'Azawad sont aujourd'hui deux visages d'un même malaise.
Les revendications kabyles s'inscrivent dans une histoire longue de marginalisation. Berceau de la culture amazighe, la région a souvent été traitée comme une périphérie rebelle par les autorités centrales.
Les grandes révoltes kabyles de 1963, 1980 (le Printemps berbère), ou encore la "Black Spring" de 2001, ont été brutalement réprimées. Aujourd'hui, le Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie (MAK) a gagné en visibilité, mais il reste interdit en Algérie, qualifié d'organisation terroriste.
À l'opposé, les mouvements touaregs au Mali, à l'instar du MNLA hier et du FLA aujourd'hui, ont reçu soutien logistique et politique de certaines puissances régionales, dont l'Algérie. Pourtant, les fondements historiques de l'Azawad comme entité indépendante sont fragiles. Avant la colonisation, les Touaregs étaient eux-mêmes divisés en confédérations parfois antagonistes. L'utopie d'un État touareg n'a jamais connu de réalité politique stable. Dès lors, ériger cette revendication en cause légitime internationale revient à nourrir l'instabilité au Sahel.
Les récentes frictions entre Alger et Bamako viennent raviver de vieilles rancunes. Le passage à Bamako de responsables algériens, notamment Attaf, exprimant leur "préoccupation" quant à la situation sécuritaire au nord du Mali, a été mal reçu. Les autorités maliennes y ont vu une posture condescendante, une tentative à peine voilée de maintenir notre pays sous tutelle diplomatique.
Plus grave encore, l'abattage d'un drone malien dans l'espace aérien malien par la défense algérienne a été interprété comme un acte hostile, voire un message politique. L'absence de démenti clair sur le soutien algérien à certains groupes armés a renforcé la conviction de Bamako : "cette puissance voisine, derrière le masque de la médiation, alimentent les foyers de tension pour garder un levier d'influence sur le Mali" entend-on dans plusieurs cercles de causerie. Aussi, le Mali s'engage- t- il vers une doctrine de rupture assumée. Face à cette situation, les autorités maliennes ont effectivement adopté un ton ferme. "Le Mali ne se laissera plus dicter sa conduite par quiconque", a déclaré un haut responsable. Une phrase qui claque comme une rupture définitive avec la logique de dépendance qui a marqué les décennies post -indépendance.
En contestant la validité actuelle de l'Accord d'Alger, Bamako affirme sa capacité à redéfinir les termes de son unité nationale. Le dialogue interne, avec les communautés du nord comme celles du sud, doit désormais se construire sans interférence. Non pas dans une logique d'exclusion, mais au nom du droit fondamental des peuples à bâtir leur avenir selon leurs propres termes.
En somme, Kabylie et Azawad posent la même question : comment concilier diversité et unité sans trahir la souveraineté ? La réponse ne viendra ni des capitales étrangères ni des groupes armés. Elle doit naître au sein des nations elles-mêmes, et s'ancrer dans la loyauté de leurs citoyens à une cause supérieure : celle de la paix, de la dignité et de l'intégrité.
Seydina Omar DICKO
Quelle est votre réaction ?
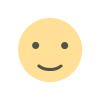 Like
1
Like
1
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
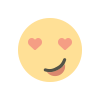 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
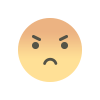 Hmmm
0
Hmmm
0
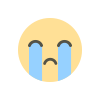 Triste
0
Triste
0
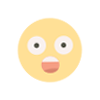 Ouah
0
Ouah
0









































