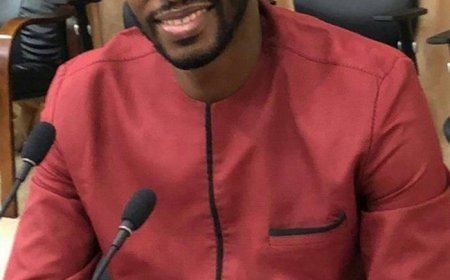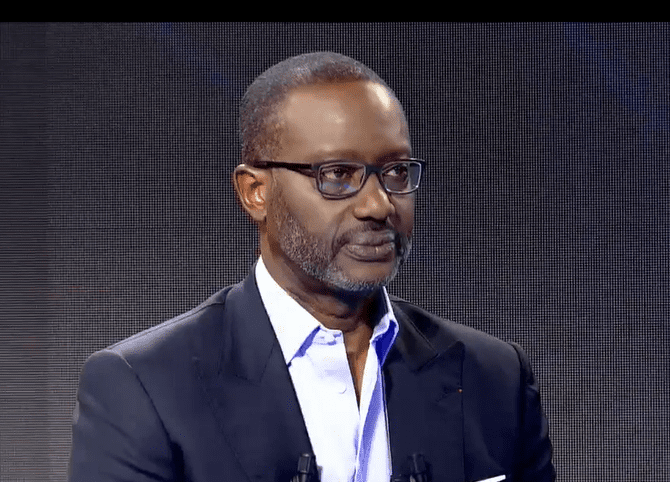Le Mali est un pays en… or. De l’empire du Ghana à la République du Mali en passant par l’empire Manding, le métal jaune a toujours été une richesse autour de laquelle ce pays a bâti son rayonnement économique. Aujourd’hui, l’orpaillage artisanal fait place à l’exploitation industrielle. Le pays compte aujourd’hui six mines d’or dans cette catégorie. Mais, même si la production est en constante augmentation, de nombreux Maliens attendent de voir encore l’impact réel de l’or sur leur vie.
« Le Mali a assigné au secteur minier un rôle moteur pour le développement durable par l'accroissement substantiel de la part des produits miniers dans le PIB », souligne Lassana Guindo, chef de la division mines de la direction nationale de la géologie et des mines (DNGM).
C’était au cours de la journée d’information organisée par le RJEM au profit des journalistes économiques du Mali. Un choix d’autant compréhensible que le sous-sol du Mali renferme de nombreux indices et gisements aurifères.
Au Mali, plus d’une vingtaine d’indices ont été mis à jour et l’information géologique de base est disponible sur toutes les provinces aurifères reconnues. Le secteur minier peut donc légitimement ambitionner d’occuper une place de choix dans l’économie malienne.
En effet, de nos jours et selon les estimations de sources bancaires, l’orpaillage produit bon an ou mal an près de deux tonnes d’or au Mali.
Les importants capitaux investis dans la recherche, la mise en évidence, l’évaluation et l’exploitation des réserves minérales donnent des résultats très appréciables, car actuellement la production aurifère occupe la deuxième place dans les recettes d’exploitation du pays après le coton.
L’Etat et les salariés les mieux « dorés »
De sources gouvernementales, la production totale d'or est passée de 44,6 tonnes en 2004 à 52,1 tonnes en 2005, soit une hausse de 16,8 %. N’empêche que le Mali est un pays minier émergent où l’exploitation minière industrielle remonte seulement aux années 1990. Mais, même s’il est évident que le secteur aurifère est une vraie aubaine pour le Mali, on se pose encore des questions comme : quel est l’impact réel de l’or sur l’économie malienne ? A qui profit l’or du Mali ?
« Le potentiel géologique du Mali est remarquable. Il se caractérise actuellement par l’essor de l’activité minière basée sur l’exploitation de nombreux gisements d’or à l’intérieur pays », souligne Modibo Traoré, chef du département économie de la Faculté des sciences économiques et de gestion (FSEG) du Mali. Face aux journalistes à la Résidence Bouna samedi dernier, il a mis en évidence l’expérience de certains pays (Canada, les pays scandinaves, l’Australie et la Nouvelle-Zélande) en matière de gestion des revenus tirés de l’or. Cet éminent professeur s’est ensuite attelé à disséquer les retombées de l’exploitation de l’or sur l’économie malienne.
De façon macroéconomique, l’or a un effet multiplicateur et d’accroissement induit. Le précieux métal peut donc jouer un rôle croissant dans le développement économique pour les pays producteurs. C’est pourquoi, ces dernières années, beaucoup de pays en voie de développement ont consenti de gros efforts pour attirer les sociétés minières sur leur sol.
Pour Modibo Traoré, l’or du Mali profite d’abord à l’Etat, aux salariés et aux fournisseurs de services. Avec une contribution évaluée à hauteur de 10 % au PIB, l’or est un véritable ballon d’oxygène pour le gouvernement. Ainsi, à titre d’impôts indirects, le Trésor public reçoit des sociétés d’exploitation des différentes mines d’or au moins 65 milliards de F CFA par an. Une contribution croissante. En effet, elle est passée de 16,680 milliards de F CFA en 2000 à 55,5 milliards de F CFA deux ans plus tard.
Et une communication présentée lors du conseil des ministres du 26 juillet 2006 faisait ressortir qu’au cours de l'année 2005, l'économie malienne a enregistré un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 6,1 % contre 2,3 % en 2004. Et que cette performance est imputable, pour une part importante, à l'augmentation de la production d'or. Quant aux transactions avec les sociétés locales, elles sont passées à plus de 292 milliards de F CFA entre de 2000 à 2005.
La répartition des revenus fait ressortir que l’Etat, les salariés des mines et les sociétés prestataires de services reçoivent, annuellement, respectivement 144, 14 milliards de F CFA, 34 milliards de F CFA et 20,3 milliards de F CFA. Les principales contributions à l’économie locale et nationale sont relatives aux CPS et taxes ad valorem, l’IRVM, la patente, les droits de douane et les dividendes.
A la lumière des exposés et du débat qui a suivi lors de la journée, il est apparu que le Mali serait aujourd’hui confronté à d’énormes difficultés socioéconomiques sans l’exploitation aurifère, qui est une ressource vitale pour l’économie malienne. Le métal jaune, par les patentes et des projets spéciaux d’investissement, joue aussi un rôle important dans le développement socio-économique des communautés d’implantation des mines.
Des communes comme Sadiola ou Morila ne reçoivent pas, annuellement, moins de 300 millions de F CFA des sociétés minières. Sans compter que l’or contribue énormément à la résorption du chômage au Mali. Les six mines en exploitation dans le pays emploient présentement près de 6000 personnes.
L’insuffisance de la valeur ajoutée
Même si, selon le chef du département économie de la FSEG, l’impact microéconomique est difficile à quantifier, il est évident que l’or du Mali ne crée pas assez de valeur ajoutée. Cela s’explique par la faiblesse de son incidence sur le développement d’un secteur comme l’artisanat (orfèvres et bijoutiers).
Dans de nombreux pays producteurs d’or, son exploitation a donné un coup de fouet à sa transformation artisanale. Ce qui n’est pas encore le cas du Mali même si M. Guindo de la DNGM a annoncé, le 29 juillet dernier, l’ouverture prochaine d’une Ecole de bijouterie avec l’appui des Sud-Africains.
En dehors des revenus directs générés par les exploitations aurifères, le Mali peut tirer davantage de profits de ses richesses aurifères avec plus de valeur ajoutée. Pour la réduction de l’effet de cyanure dans l’extraction et le traitement du minerai, les sociétés d’exploitation utilisent quotidiennement au moins 160 tonnes de ciment. Une quantité entièrement importée du Sénégal. Ce qui a d’ailleurs conduit ce pays à construire une seconde cimenterie pour approvisionner les mines maliennes. Une nouvelle cimenterie, donc un nombre conséquent de nouveaux emplois créés au profit de ce pays.
Et pourtant, des mines comme celles de Sadiola se trouvent à seulement 45 km de Diamou, une cimenterie qui demeure inexplicablement fermée malgré ses immenses potentialités. Aucune raison objective ne peut aujourd’hui justifier la non-exploitation de cette immense richesse. A moins que ce ne soit pour des raisons politiques. En effet, il ne sera pas surprenant que la réouverture soit volontairement bloquée par ceux qui bénéficient de la largesse de ceux qui ont fait fortune grâce au monopole de l’importation.
Dans le temps, le seul argument que les autorités avançaient était l’enclavement du gisement. Il fallait transporter la production par chemin de fer. Ce qui augmentait le coût de production et rendait le ciment produit à Diamou moins compétitif sur le marché. Mais, aujourd’hui, la route a énormément avancé au Mali, notamment dans la région de Kayes. Le ciment importé sur près d’un millier de kilomètre de Dakar à Sadiola ou Morila peut-il être plus compétitif que celui produit à moins d’une centaine de km des mines comme Yatela ou Loulo ?
Ce qui sûr c’est que cette importation prive le Mali d’un grand potentiel d’emplois et de ressources financières pouvant relancer et consolider la croissance économique du pays. Par exemple, même le transport du ciment entre le Sénégal et les mines du Mali est assuré à 90 % par les transporteurs sénégalais. Ce sont là autant de potentialités inexploitées qui auraient permis au Mali et aux Maliens de profiter d’avantage de leur trésor de tous les temps : l’or.
Si l’on veut que l’exploitation aurifère profite aux Maliens, il faudra créer les conditions lui permettant de générer davantage de valeur ajoutée. Il est inadmissible que les bijoux et autres parures en or fabriqués aux Emirats arabes unis continuent à inonder le marché d’un pays comme le Mali classé au 3e rang des pays africains producteurs d’or.
Moussa Bolly
|
Consolider les acquis
Aujourd’hui, il est nécessaire de consolider les acquis du pays dans l’exploitation minière par la diversification des substances minérales exploitées vu le potentiel du pays (fer, bauxite, cuivre, plomb, zinc, pierres fines, diamant et les matériaux de construction). Il est question ces derniers jours de la présence de la bauxite dans la région de Sikasso.
Pour le chef de la section mines de la DNGM, cette consolidation passe par la mise en place par l’Etat d’infrastructures de base (cartographie géologique et inventaire minier conséquents du pays), d’infrastructures routières et énergétiques couvrant toutes les zones minières et partant tout le territoire du pays. Tout comme il est nécessaire de mettre en place des structures fiables de suivi et de contrôle des activités minières avec une réglementation conséquente et d’un système de financement approprié aux activités des opérateurs économiques nationaux pour asseoir un développement durable de l’économie du pays.
Il est aussi important de ne pas bâtir tous nos plans de développement sur nos richesses minières. Même si les réserves d’or exploitables sont estimées à 350 tonnes, les autorités maliennes ne doivent pas oublier que le métal jaune est une ressource non renouvelable et la plupart des gisements en exploitation aujourd’hui ont été identifiés à la suite des travaux s’étendant sur une dizaine d’années.
Et selon les géologues, la production d’or chutera beaucoup en 2011 suite à la fermeture de certaines mines comme Morila et à la baisse des teneurs. Autant alors donner les moyens au département des mines de la DNGM d’intensifier les recherches pour l’identification d’autres gisements.
M. B.
|
"
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0