L’objectif de ce texte est de discuter la rationalité juridique des sanctions prises ces derniers mois par la CEDEAO. Une justification de ces sanctions a été apportée en ces termes : « Les gouvernements du G5 Sahel peuvent difficilement cautionner un coup d’État en son sein, d’autant plus que tous craignent d’en être victimes (...) l’organisation régionale qui est considérée comme la plus légitime pour intervenir dans les affaires intérieures et aider au retour de la stabilité politique du Mali dans le cadre d’institutions démocratiques est la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest». Déjà, lors du premier coup d’État du 18 août 2020 écartant feu le président Ibrahim Boubakar Keita du pouvoir, un train de sanctions avait été pris aboutissant à la fermeture des frontières des États de la CEDEAO limitrophes du Mali ; les négociations ont débouché sur la mise en place d’un gouvernement civil de transition dirigé par Bah N’Daw, devant mener au rétablissement de «l’ordre constitutionnel ». Un nouveau coup d’État est intervenu en mai 2021, conduisant à la situation actuelle. Au total, trois vagues de sanctions ont été infligées par la CEDEAO envers la République du Mali : août 2020, novembre 2021, janvier 2022. L’examen de ces événements éclaire les transformations que connaît l’institution depuis plusieurs années. Le but initial du traité lié à l’intégration sous-régionale par le marché et la solidarité entre les États cède progressivement la place à une Communauté endossant le rôle de gendarme de la stabilité politique régionale.
Depuis près de dix ans, le territoire malien est divisé entre plusieurs groupes armés djihadistes, nationalistes, etc. impliqués dans un conflit multidimensionnel. La rudesse des échanges récents entre la République du Mali et la CEDEAO mais aussi la communauté internationale est liée, de près ou de loin, au choix du gouvernement malien de faire appel à la Russie afin de suppléer progressivement la présence militaire française et européenne (EUTM, MINUSMA), mais surtout de la volonté de la junte au pouvoir de prolonger la transition. L’explication du raidissement lié à cette situation est multiple. Les causes tiennent, sans prétendre à l’exhaustivité, à la posture souverainiste de la junte au pouvoir, à l’inefficacité de la présence militaire française, à la persistance de l’insécurité, etc. Un regain de tension a eu lieu lorsque les autorités maliennes ont décidé d’expulser l’ambassadeur de France du Mali à la suite des propos du ministre français des Affaires étrangères, J-Y. Le Drian, qualifiant la junte « d’illégitime » et affirmant qu’elle était « hors de contrôle » chose extrêmement rare en Afrique francophone depuis la Guinée de Sékou Touré. Cette expulsion a été précédée de celle du contingent danois intégré dans la Task force dite « Takuba », au motif tiré de l’illégalité de la présence des forces danoises sur le sol malien. La Suède a, quant à elle, annoncé le retrait de ses effectifs de la Task-force «Takuba» pour mars 2022. La Norvège vient de renoncer à l’envoi de militaires au sein de ladite force, en raison du refus du gouvernement malien. Le président français annonce, le 17 février, le retrait « gradué » de la force Barkhane et de ses alliés européens. En réponse, le gouvernement malien demande le départ immédiat des soldats français. Le 3mars, la France a rappelé l’ensemble des coopérants exerçant au sein de l’administration malienne. De toute évidence, un rapport de force durable s’est instauré entre la France et le Mali dans un contexte de défiance d’une partie de l’opinion publique africaine à l’égard de la présence militaire française en Afrique. Les uns invoquent la souveraineté nationale, pendant que les autres appellent le Mali au respect de ses obligations internationales et sous-régionales et à la restauration de l’« ordre constitutionnel». Derrière ces discours se dissimulent, à l’évidence, des intérêts divergents. Nul n’ignore, pour le dire vite, l’enjeu stratégique que représente le Mali pour le contrôle de la gestion des flux migratoires européens ; et personne n’est assez naïf pour croire que les militaires au pouvoir, aussi nationalistes soient-ils, ne concèderont pas aux nouvelles puissances étrangères russes convoquées sur le territoire malien un certain nombre de prérogatives futures. Ce qui apparaît en revanche inédit, c’est bien la manière décomplexée avec laquelle les autorités maliennes ont décidé de tourner la page des relations militaires eurafricaines dans un contexte où la force Barkhane était de plus en plus perçue par la population comme une force d’occupation. Plusieurs couches d’analyse se superposent. Il y a d’abord un enchevêtrement d’accords internationaux justifiant sur le plan juridique une assise à la présence militaire française puis européenne sur le sol malien ; s’y ajoutent, les médias en parlent peu, plusieurs décisions rendues par la Cour constitutionnelle malienne, notamment celle du 29 mai 2021 validant la direction du Conseil National de Transition (ci-après CNT) menée par le colonel Assimi Goïta, président, et Choguel Maïga, Premier ministre. Enfin, au plan régional, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est illustrée par un train de sanctions infligées à l’encontre de l’État malien. On ne peut que relever l’absence de données claires, de part et d’autre, quant au contenu des accords dénoncés. L’objectif de ce texte est de discuter la rationalité juridique des sanctions prises ces derniers mois par la CEDEAO. Une justification de ces sanctions a été apportée en ces termes : « Les gouvernements du G5 Sahel peuvent difficilement cautionner un coup d’État en son sein, d’autant plus que tous craignent d’en être victimes (...) l’organisation régionale qui est considérée comme la plus légitime pour intervenir dans les affaires intérieures et aider au retour de la stabilité politique du Mali dans le cadre d’institutions démocratiques est la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest». Déjà, lors du premier coup d’État du 18 août 2020 écartant feu le président Ibrahim Boubakar Keita du pouvoir, un train de sanctions avait été pris aboutissant à la fermeture des frontières des États de la CEDEAO limitrophes du Mali ; les négociations ont débouché sur la mise en place d’un gouvernement civil de transition dirigé par Bah N’Daw, devant mener au rétablissement de «l’ordre constitutionnel ». Un nouveau coup d’État est intervenu en mai 2021, conduisant à la situation actuelle. Au total, trois vagues de sanctions ont été infligées par la CEDEAO envers la République du Mali : août 2020, novembre 2021, janvier 2022. L’examen de ces événements éclaire les transformations que connaît l’institution depuis plusieurs années. Le but initial du traité lié à l’intégration sous-régionale par le marché et la solidarité entre les États cède progressivement la place à une Communauté endossant le rôle de gendarme de la stabilité politique régionale. L’exercice de cette nouvelle fonction figurant dans le traité n’est pas sans risques comme le montre l’exemple malien, notamment lorsque la CEDEAO se place en porte-à-faux vis-à-vis de la légitimité populaire au soutien du pouvoir en place. Ce risque est d’autant plus accru quand il donne l’impression de rejoindre les intérêts de la « communauté internationale » il faut comprendre ici occidentale. En Afrique de l’Ouest, la vague des coups d’État est liée à plusieurs facteurs comme la mauvaise gestion et la corruption des pouvoirs civils. Elle place la CEDEAO face à un dilemme insoluble : soutenir les nouveaux pouvoirs militaires en place au risque de miner la légitimité d’action de la conférence des chefs d’État et de gouvernement ou condamner lesdits coups d’État soutenus par la rue (cas du Mali et du Burkina Faso) en se privant auprès des nouveaux pouvoirs en place de son autorité régionale liée au maintien de la paix. Il faut adjoindre à ce contexte régional une nouvelle rivalité internationale entre l’Occident, la Chine et la Russie autour du continent africain.
Crise politique malienne et « médiation » de la CEDEAO : une relecture à travers la jurisprudence de la Cour constitutionnelle du Mali.
Huit mois avant le communiqué de la CEDEAO, la Cour constitutionnelle malienne rend un arrêt validant le processus de transition actuellement en contestation. De quoi s’agit-il ? Le 27 mai 2021, la Cour est saisie par le ministre, directeur de cabinet du vice-président de la transition de la lettre de démission du président de la transition, ainsi que du décret pris le 24 mai 2021, mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. De toute évidence, l’objet de la saisine vise à se prononcer sur la légalité du changement constitutionnel opéré depuis l’institution des autorités de transition. La Cour constate dans un premier temps que les dispositions de la constitution malienne de février 1992 ne peuvent s’appliquer en l’espèce. Cette constitution prévoit, à l’image de la constitution française adoptée sous la Ve République, que la vacance de la présidence de la République ne peut être suppléée que par celle du président de l’Assemblée nationale. Or, d’un point de vue matériel et dans la situation en cause, il n’existait pas de parlement. Comme on va le voir, la Cour s’était déjà prononcée sur ce vide juridique. Dans l’arrêt qui nous importe ici, la Cour valide la démission du président de la transition et juge conforme à la constitution son remplacement par le vice-président de la transition, en l’occurrence le colonel A. Goïta. C’est de cet arrêt qu’il faut partir pour comprendre les réactions de la CEDEAO. Et si l’on veut saisir le problème dans sa complexité juridique, un détour apparaît nécessaire. Il faut se rappeler que, dès avril 2020, la même Cour constitutionnelle a invalidé une trentaine d’élections parlementaires, notamment dans plusieurs circonscriptions. Dit rapidement, la Cour juge dans cet arrêt de 77 pages particulièrement circonstancié et détaillé que les conditions dans lesquelles se sont déroulées la campagne et les élections législatives dans une trentaine de circonscriptions ne permettaient pas de valider l’élection des députés qui en sont issus. Un recours en « rectification » de l’arrêt du 30 avril fut introduit par les candidats à la députation dont l’élection avait été invalidée par les juges. À nouveau, la Cour rejette les recours au motif que l’article 10 du règlement intérieur invoqué devant elle par les requérants portait sur les cas de rectification d’erreur matérielle qu’il ne fallait pas confondre avec l’erreur de droit. Pour le dire d’une manière plus simple, les requérants cherchaient à ce que la Cour revienne sur sa jurisprudence, en se fondant sur une interprétation contraire à sa décision antérieure.
La tension sociale était à son comble et plusieurs manifestations menées par le mouvement dit du 5 juin-RFP furent réprimées dans le sang, faisant plus d’une vingtaine de morts. Ce mouvement hétéroclite, composé de personnalités issues de la société civile, de responsables religieux et politiques exige, dans un communiqué adressé aux chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO, la démission du président I. B. Keita. Le pouvoir exécutif et une partie de la classe politique font entendre un autre son de cloche : les revendications du mouvement du 5 juin-RFP sont instrumentalisées à l’encontre de la Cour constitutionnelle qui devient la cible d’attaques politiques virulentes. D’aucuns ont appelé à sa dissolution, voire à l’utilisation de l’article 50 de la Constitution de1992 sur l’état d’urgence par le président de la République. En juillet 2020, I. B. Keita décide d’abroger les décrets de nomination d’un certain nombre de membres de la Cour constitutionnelle. Les motifs de ce décret imputent cette procédure d’abrogation tant à l’opposition (mouvement du 5 juin) qu’à la contestation « par une partie de la classe politique et de la société civile» de la proclamation des résultats du second tour de l’élection législative du 19 avril 2020. Sans attendre l’adoption des décrets révoquant leur nomination, cinq juges de la Cour démissionnent. Au cœur de la crise, le président I. B. Keita affirme vouloir se conformer aux recommandations de la mission de médiation de la CEDEAO proposant de mettre en place de nouvelles élections partielles dans les circonscriptions où les élections législatives avaient été invalidées par la Cour. Les recommandations de cette mission, conduite par le ministre des Affaires étrangères du Niger, K. Ankourao, font porter à la Cour l’entière responsabilité des troubles sociaux. La mission en appelle à « reconsidérer les résultats issus des élections législatives» et à « envisager une relecture des textes régissant la Cour constitutionnelle ». En juillet 2020, le président Keita constitue un gouvernement restreint, toujours contesté par la rue. La CEDEAO menace, elle aussi, d’infliger des sanctions à toutes celles et ceux qui ne se conformeraient pas à l’« ordre constitutionnel » en place. On sait ce qu’il en advint : le 18 août 2020, le pouvoir du président I. B. Keita est renversé par un coup d’État militaire soutenu par la rue. Le lendemain, la CEDEAO annonce une série de sanctions économiques lourdes consistant dans le gel des avoirs du Mali, la fermeture des frontières, la suspension de la participation du pays aux décisions de la CEDEAO, la restriction des déplacements de plusieurs officiels maliens. Ce premier train de sanctions est appuyé par la communauté internationale (Conseil de sécurité de l’ONU, Banque mondiale, UE, États-Unis). Les sanctions demandent le rétablissement du président I. B. Keita dans ses fonctions antérieures tout en saluant le décret abrogeant la nomination des juges constitutionnels maliens (point 9 de la déclaration). En septembre 2020, un « compromis » est trouvé à Accra, devant mener à l’instauration d’une transition civile ainsi qu’à la tenue de nouvelles élections sous 18 mois. Cette médiation est menée sur le fondement du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. La levée de l’embargo, qui intervient le 5 octobre 2020, est conditionnée par l’instauration d’un comité national de transition à deux têtes ainsi que la nomination de civils à des postes politiques clés. Une charte de transition est adoptée le 12 septembre 2020 et promulguée le 1er octobre 2020. Elle est précédée de la nomination d’un civil, M. Ouane, au poste de Premier ministre le 27 septembre 2020. Elle prévoit une transition d’une durée de 18 mois. Quelques explications apparaissent nécessaires quant au contenu de cette charte de transition. Une première version prévoyait que le vice-président de la transition (A. Goïta) pourrait remplacer, en cas d’empêchement, le président de la transition, B. N’Daw. Cette version dans laquelle le vice-président pouvait potentiellement être amené à exercer de larges prérogatives en matière de défense, de sécurité et de réforme de l’État fut modifiée à Accra sous la pression des chefs d’État de la CEDEAO. Dès l’origine, des divergences et un manque de confiance apparaissent entre les officiels maliens et la CEDEAO. De nombreuses questions restent pendantes : le mandat de l’institution lui permet-il de s’immiscer à ce point dans les affaires régaliennes d’un État souverain ? D’abord en disqualifiant explicitement la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et en voulant maintenir l’ancien pouvoir contesté par la rue du président I. Keita, ensuite en imposant le choix d’acteurs politiques à des postes ministériels régaliens, enfin en exigeant la tenue d’un calendrier électoral pour 2022 ?
À dire vrai, la frontière entre médiation et tutelle est franchie à plusieurs reprises sans que l’étendue juridique de la médiation engagée par la CEDEAO sur le fondement du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance soit interrogée. En réalité, et tout au long de cette affaire, les considérations politiques ont toujours pris le pas sur les questions juridiques. Le 18 décembre 2020, la nouvelle Cour constitutionnelle se prononce sur la légalité de la charte de transition au regard de l’article 86 de la constitution de 1992. Sur le fond, la Cour juge illégal l’article 2 du règlement intérieur (lui-même déduit de l’article 13 de la charte) de la charte qui prévoit que « les membres du comité national de transition portent le titre de députés de la transition ». L’arrêt substitue l’expression plus neutre de « membres du CNT ». La raison en est simple : la qualité de député s’obtient par l’élection au suffrage universel, sans quoi on ne peut parler de pouvoir législatif. La Cour censure aussi la nomination des questeurs du nouvel organe législatif par voie de décret. Elle rappelle le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, tout en censurant plusieurs erreurs, imprécisions ou incohérences matérielles figurant dans la charte. Le même jour, un décret instaure l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national ; sa durée est prolongée par une ordonnance du 30 décembre 2020. On reviendra, simplement pour le rappeler, sur les relations conflictuelles entre le Premier ministre et le président de la transition, d’un côté, et le vice-président, de l’autre. Cette méfiance réciproque empoisonne la première transition. Un second coup d’État intervient, ce faisant, le 24 mai 2021. Le 26 mai, B. N’Daw et M. Ouane sont contraints de démissionner de leurs postes respectifs. C’est dans ce contexte que la Cour constitutionnelle rend l’arrêt du 28 mai précité, dans lequel elle juge valide le remplacement au poste de président de la CNT par le vice-président, A. Goïta. Le raisonnement adopté à cet égard se fonde sur une lecture combinée des articles 7 et 8 de la charte de transition : « Le président de la transition est secondé par un vice-président. Il est désigné suivant les mêmes conditions que ce dernier (...) tout candidat aux fonctions de président et de vice-président peut être un civil ou militaire ».Si l’on s’en tient à la lettre du texte, rien dans la charte ne vient contredire l’interprétation rendue par la Cour. Certes, l’accord politique avec la CEDEAO prévoyait que les fonctions de président et de vice-président ne pouvaient être interchangeables. Cela ne ressort pourtant pas des dispositions de la charte (le délai de 18 mois issu du « compromis » d’Accra n’étant pas remis en cause par la Cour). Faut-il y voir une forme de cynisme, d’incompétence de la part des rédacteurs de la charte ou de réalisme des juges ? On penche pour la dernière branche de l’alternative, dans la mesure où, comme le mentionne l’arrêt, le second coup d’État plaçait les institutions de la République malienne dans un vide juridique nuisible à terme à la stabilité du pays. S’y ajoute le fait que la charte de transition ne comporte aucune transposition de « l’accord » politique de la CEDEAO dont il faut rappeler que les dispositions ne sont pas directement applicables dans les ordres juridiques nationaux. Les contraintes de la Cour sont par conséquent très fortes. Elle ne peut prendre le risque d’entériner la vacuité du pouvoir sans une nouvelle contestation populaire ; elle ne peut davantage donner force juridique aux recommandations politiques formulées par la CEDEAO dont les termes ne figurent pas dans la charte qui lui est donnée d’interpréter.
Le choix des juges apparaît dans ces conditions pragmatique : il prend acte de la « légitimité » du colonel A. Goïta et du mouvement du 5 juin-RFP l’ayant conduit au pouvoir. Il ne s’agit nullement pour la Cour d’attribuer aux nouvelles autorités un blanc-seing, dans la mesure où elle considère (s’agissant par exemple du régime juridique des députés) que les autorités de transition ne disposent que d’une légitimité partielle. En d’autres mots, la Cour reconnaît bien le caractère transitionnel (et donc provisoire) du processus politique en cours. Si les juges ne cherchent pas à en freiner le déroulement (sans doute afin de ne pas générer une nouvelle crise nationale), la Cour lui dénie tout caractère durable d’un point de vue constitutionnel. En décembre 2021, la Cour a de nouveau été saisie par les nouvelles autorités en place de la modification du règlement intérieur de la charte. Des assises nationales de refondation se sont tenues entre-temps, repoussant la possibilité d’organiser de nouvelles élections à la date proposée par la CEDEAO. Les dispositions modifiées du règlement intérieur de la charte visent pour la plupart à rendre plus efficace le travail parlementaire. Une seule modification est censurée en ce qu’elle viole le principe de séparation des pouvoirs tel que la Cour l’avait rappelé dans sa jurisprudence antérieure. L’arrêt ne se prononce pas en revanche sur le délai de 18 mois fixé par la CEDEAO (article 22 de la charte) : à sa décharge, la Cour n’était pas saisie de cette question. Des assises nationales de la refondation, il ressort que l’organisation d’élections pour 2022 n’est pas tenable. Une transition militaire de « cinq années » est suggérée à la place, ce que rejette catégoriquement la CEDEAO. Cette durée repose sur un programme politique ayant pour objectif la restauration progressive des institutions de l’État sur l’ensemble du territoire malien. Les arguments qui ressortent du communiqué de la CEDEAO font état du non-respect des engagements pris à Accra, de la violation d’un certain nombre de principes « démocratiques » et, à terme, d’un risque d’instabilité régionale. C’est dans ces conditions que la Communauté appelle au rétablissement de « l’ordre constitutionnel». Le 14 janvier 2022, des manifestations massives se tiennent à travers le pays à l’encontre du troisième train de sanctions infligé par la CEDEAO et la présence militaire française. Par-delà les simplifications rapides, l’aspiration du peuple malien est prise en étau entre un pouvoir militaire bénéficiant certes d’une légitimité populaire certaine, mais dont la prise de pouvoir soulève des problèmes importants en matière de garantie des libertés fondamentales et une Communauté faisant preuve d’une intransigeance stérile.
De quoi le retour à « l’ordre constitutionnel » est-il le nom ?
Cette étape de l’exposé requiert plusieurs remarques de fond. Une première incohérence « démocratique », interne au système politi-co-normatif malien, tient dans la contestation, dès 2020, de la Cour par un pouvoir exécutif (soutenu par la CEDEAO), censé formellement en garantir l’indépendance. Tout porte à croire qu’à partir du moment où la Cour a rendu l’arrêt invalidant partiellement plusieurs élections législatives, le pouvoir exécutif en place et la CEDEAO ont décidé ouvertement de remettre en question son autorité. On ne peut mieux illustrer cette pratique du fait du prince ou de commandant de cercle. Insatisfait de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, le pouvoir exécutif, aidé par l’autorité sous-régionale censée apporter son soutien à la stabilité du pays, décide explicitement de se débarrasser des juges en place. L’enchaînement des événements qui suivent le prononcé de l’arrêt invalidant partiellement les élections législatives est à cet égard important. Le président de la République de l’époque, I. B. Keita, avait décidé de révoquer une partie des juges de la Cour alors même qu’il est censé en garantir l’indépendance (articles 45, 81, 82 de la constitution de 1992).
À notre connaissance, aucun communiqué de la CEDEAO n’est intervenu pour rappeler le pouvoir exécutif à ses obligations. Pourtant, le protocole additionnel du 21 décembre 2001 (A/SP1/12/01) sur la démocratie et la bonne gouvernance du traité de la CEDEAO garantit en son article 1 de la même section (« Des principes de convergence constitutionnelle») la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. C’est contre la préservation de ces principes que s’érige le pouvoir exécutif lorsqu’en juillet 2020, l’ancien président I. B. Keita, appuyé par la CEDEAO, impute directement les causes des troubles sociaux ayant secoué le Mali de mai à juillet 2020 à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle malienne. Pour s’être généralement présenté comme la réplique institutionnelle de l’Union européenne, le communiqué de la CEDEAO du 19 juin 2020 prend ici une direction radicalement opposée. Personne n’imagine un instant la Commission européenne mettre en cause l’impartialité du pouvoir judiciaire polonais au sein de l’Union. L’indépendance des pouvoirs doit au contraire être protégée au regard des textes supranationaux. Les divergences politiques, lorsqu’elles se font jour, se règlent devant la Cour de justice de l’Union. Le problème qui se pose ici est que la CEDEAO censée aider à la résolution des tensions d’un de ses pays membres fondateurs n’hésite pas à remettre en question une de ses institutions fondamentales. Rien ne semble plus maladroit dans un contexte lié à l’humiliation nationale collective que représente la présence sur le sol malien de forces étrangères depuis dix ans. On ne saurait mieux s’y prendre pour galvaniser l’unité nationale autour du pouvoir en place. Plus étonnant est l’appel au rétablissement de « l’ordre constitutionnel » comme si, là encore, les décisions rendues par la plus haute juridiction constitutionnelle nationale y compris la nouvelle Cour constitutionnelle pourtant issue des recommandations de la Communauté étaient purement et simplement ignorées par la CEDEAO. C’est d’ailleurs ce qui ressort de la lecture des différents communiqués. Au-delà des divergences de calendrier électoral, fallait-il en référer au respect des principes démocratiques dans un espace sous-régional où la majorité des pouvoirs en place ne peuvent se targuer d’être vertueux en matière d’élections ? Les récents coups d’État en Guinée et au Burkina Faso en constituent des témoignages éclatants. La multiplication des coups d’État militaires est aussi liée à des modifications constitutionnelles illégitimes, sans que la CEDEAO réagisse avec autant de vigueur. Comment comprendre cette fixation pour un retour à « l’ordre constitutionnel » ? Le sens des mots importe : la CEDEAO ne peut l’ignorer. Exiger un retour à « l’ordre constitutionnel » dans un pays divisé depuis dix ans, gouverné par un pouvoir corrompu dont l’ancien chef d’État n’a pas hésité à remettre en question ledit «ordre constitutionnel », en fonction de ses ambitions politiques personnelles, laisse songeur. Mettre l’accent sur l’établissement d’un calendrier électoral et d’un chronogramme apparaît, dans cette longue période de déstabilisation que connaît le Mali, incongru. S’y référer sans proposer une sortie de crise concertée et conforme aux attentes du peuple malien semble d’autant plus hasardeux : la CEDEAO privilégie-t-elle le retour à la stabilité régionale au détriment des intérêts nationaux ? Les milliers de morts, destructions de villages, déplacements massifs de population, fermetures d’écoles et de services publics qui émaillent le quotidien du pays depuis près de dix années ne valent-ils pas mieux qu’un retour expéditif à « l’ordre constitutionnel » manifestement déconnecté du quotidien d’une grande partie de la population ? Voilà une série de questions de bon sens que tout un chacun au fait de la crise malienne ne peut s’empêcher de poser. Les différents communiqués de la CEDEAO ne permettent pas de se faire une idée précise de la façon dont l’institution se représente « l’ordre constitutionnel » qu’elle réclame. Toute cette précipitation laisse penser que le Mali ne mériterait rien de plus qu’un vernis de stabilité à court terme pour ne rien dire d’une démocratie de façade, quitte à retomber dans les errements de l’ancien pouvoir en place. Qu’en est-il de la situation socioéconomique, pour ne rien dire de celle militaire ? Manifestement, la CEDEAO envisage les événements politiques du Mali moins pour eux-mêmes que pour le risque de « contamination » politique qu’ils seraient susceptibles d’engendrer, ce qui est déjà le cas au Burkina Faso et en Guinée.
Une seconde observation tient à la forme juridique utilisée par la CEDEAO pour contraindre le Mali à se plier aux recommandations qu’elle formule. Si l’on s’en tient par exemple au communiqué du 19 juin 2020, force est de reconnaître que l’institution sous-régionale attribue à ses communiqués une valeur pour le moins extensive. Au nom de quoi une médiation pourrait-elle primer sur le droit positif national en vigueur ? Car c’est bien de cela qu’il s’agit : le fondement juridique du communiqué de la délégation ministérielle du 19 juin 2020 repose, si on se réfère au protocole additionnel du 21 décembre 2001, sur les articles 12 3) à 18. Il ressort de ces articles que les recommandations formulées par une mission de la CEDEAO n’ont aucune force normative sans doute est-ce bien à ce titre qu’on les qualifie de simples recommandations. Elles sont adressées au secrétariat exécutif de la CEDEAO qui peut « (...) décider des mesures à prendre ». Or, s’agissant du Mali, tout s’est passé comme si les préconisations de certaines médiations disposaient intrinsèquement d’une autorité supranationale suffisamment contraignante pour s’appliquer directement dans l’ordre juridique malien. C’est là une confusion juridique regrettable aux conséquences multiples : discrédit du pouvoir judiciaire en place, remise en cause de la légitimité de la CEDEAO aux yeux du peuple malien, première victime des sanctions économiques infligées.
La légalité des sanctions infligées en question
C’est l’occasion de rappeler, à contre-courant du discours ambiant, que la décision sanctionnant la participation du Mali aux institutions de la CEDEAO constitue bien un acte juridique, quand bien même cet acte serait pris sous forme de communiqués émanant des chefs d’État et de gouvernement. Par conséquent, il est tout à fait loisible pour le gouvernement malien d’attaquer ledit acte devant la Cour de justice de la CEDEAO. À défaut, l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (consacrant le droit à être entendu, lequel fait partie des sources du droit de la Communauté) et le droit à un procès équitable seraient vidés de tout contenu. Telle est la condition permettant d’assurer au gouvernement malien, comme à tout autre État membre, un droit de défense minimal. Avant d’en venir au détail des sanctions prises par la CEDEAO, sans doute convient-il de se faire une idée globale de l’étendue des sanctions internationales infligées au gouvernement malien. Le premier train de sanction de la CEDEAO (août 2020) fut accompagné d’une résolution du Comité permanent de la francophonie (OIF) qui, par la voix de sa secrétaire générale, condamne la prise de pouvoir des militaires et appelle aussi au retour à « l’ordre constitutionnel ». La Banque mondiale, de son côté, suspend provisoirement ses décaissements lors du second coup d’État de mai 2021 avant de reprendre sa coopération avec le gouvernement malien en septembre de la même année. L’Union africaine, se fondant sur l’avis du Conseil paix et sécurité (CPS), a suspendu le Mali (à deux reprises, respectivement lors du premier et du second coup d’État) de sa participation aux activités de l’UA tant que le retour à « l’ordre constitutionnel » et au délai d’organisation d’élections sous 18 mois ne serait pas respecté. Les conclusions rendues par la mission paix et sécurité en juillet 2021 saluent les efforts entrepris par les autorités maliennes tout en exprimant sa vigilance quant à l’organisation à court terme d’élections indépendantes. Elles en appellent à la solidarité des États de l’UA dans la mise en œuvre des priorités stratégiques définies par le gouvernement malien pour l’année 2021-2022. Enfin, réunie en session extraordinaire à Accra le 9 janvier 2022, la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UEMOA relève « l’absence de progrès dans le processus de restauration d’un ordre constitutionnel et démocratique normal au Mali (...) ». Elle décide non seulement « d’endosser les sanctions » infligées par la CEDEAO, mais aussi en impose de nouvelles : « incluant notamment des sanctions économiques et financières ». Elle suspend de surcroît le Mali de sa participation à l’institution. La BCEAO décide d’agir de même, en gelant les avoirs du Mali. Terminons ce panorama en évoquant le soutien apporté par les États-Unis, la France et l’Union européenne aux sanctions prises par la CEDEAO. Le compte rendu du représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU au Mali est plus nuancé, dans la mesure où il appelle à prendre en considération les travaux des assises nationales de la refondation qui devaient servir de base à un futur accord de paix. Le 11 janvier, la Chine et la Russie se sont opposées à l’adoption d’une résolution introduite par la France et les États-Unis, proposant de soutenir les sanctions infligées par la CEDEAO à l’égard du Mali. La nature des sanctions qui figurent dans le dernier communiqué final du sommet extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO publié le 9 janvier 2022 est essentiellement d’ordre économique, diplomatique et politique. Elles vont du rappel des ambassadeurs des pays membres de la CE-DEAO au Mali, en passant par la fermeture des frontières terrestres et aériennes, la suspension des transactions commerciales - en dehors des produits de première nécessité, le gel des avoirs de la République malienne dans les comptes de la BCEAO ou la suspension des transactions financières en faveur du Mali par la BIC et la BOAD. Moins médiatisé a été le point 12 du communiqué du 9 janvier précité par lequel la CEDEAO « (...) décide d’activer immédiatement la force en attente (...) qui doit se tenir prête à toute éventualité». L’option militaire n’est, par conséquent, guère écartée. Les motifs de ces sanctions tiennent dans le non-respect des engagements pris lors de la conférence qui s’est tenue à Accra en septembre 2020. La CEDEAO demande l’organisation rapide d’élections à court terme et rejette le délai de 5 ans issu des assises nationales de la refondation. Les sanctions précédentes (16 septembre 2021) étaient ciblées, visant les officiels maliens et leur famille. Les premières sanctions qui suivent le premier coup d’État (20 août 2020) suspendent la participation du Mali aux organes de la CEDEAO, l’arrêt total des échanges économiques tout en ciblant les putschistes, leurs partenaires et leurs collaborateurs. Les sanctions doivent par conséquent être systématisées en fonction des acteurs. Celles prises par la CEDEAO et l’UEMOA sont de loin les plus étendues ; celles adoptées par l’Union européenne et l’Union africaine demeurent, dans une certaine mesure, ciblées. Enfin, au plan international, la CEDEAO est soutenue par un ensemble de pays occidentaux (et d’institutions telles que la Banque mondiale) plus ou moins actifs d’un point de vue diplomatique (l’ancienne puissance coloniale étant la plus active de toutes)…
A suivre dans notre prochaine édition.
Lionel Zevounou
Université Paris Nanterre Centre de théorie
et Analyse du droit (UMR, 7074) CORA
(Collectif pour le renouveau africain)

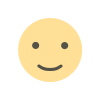 Like
0
Like
0
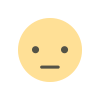 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
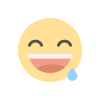 Drôle
0
Drôle
0
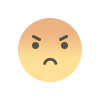 Hmmm
0
Hmmm
0
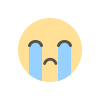 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0














































