
Le réalisateur marseillais Robert Guédiguian tourne « Mali twist » au Sénégal, et entend recréer l’atmosphère festive des premières années de l’indépendance. Jeune Afrique s’est invité sur le plateau.
Bamako, années 1960. Lara et Samba ont à peine vingt ans et s’aiment dans le Mali de Modibo Keïta. Samba est un membre des pionniers, mouvement national de la jeunesse socialiste. Il rêve de justice et d’égalité et entraîne dans son combat politique la jeune Lara, qui s’est échappée de son village après avoir subi un mariage forcé. Militants le jour, noceurs la nuit, les deux amoureux écument les clubs de la capitale lorsque le soleil se couche, où ils dansent au rythme du twist et du blues, de Otis Redding à Johnny Hallyday, ou encore Ray Charles.
C’est cette histoire d’amour et d’émancipation, et celle de l’expérience inachevée du socialisme panafricain à laquelle Modibo Keïta rêvait, que le réalisateur français Robert Guédiguian a voulu raconter. S’il s’est éloigné des calanques de Marseille, décor de nombreux de ses films – c’est son premier tournage sur le continent –, il n’en est pas moins resté proche de ses thèmes de prédilection : l’entraide, la collectivité, la solidarité. L’amour et la fête, aussi.
Jusqu’au bout de la nuit
C’est en visitant, à Paris, l’exposition « Mali twist » de la Fondation Cartier pour l’art contemporain, rétrospective de l’œuvre du photographe malien Malick Sidibé, que Robert Guédiguian découvre l’histoire de ces nuits folles du nouveau Mali indépendant, lorsque l’on recensait à Bamako pas moins de 200 clubs de danse différents, et que les jeunes se déhanchaient librement jusqu’au bout de la nuit.
Après les photographes Hassan Hajjaj (Maroc) ou Omar Victor Diop (Sénégal) – entre autres –, c’est au tour du Marseillais de s’inspirer du maître Sidibé [décédé en 2016], de ses photographies qui laissent deviner des nuits endiablées, de ses modèles à la peau souvent luisante de sueur, débordants de charme et de classe. Avec un pari : celui de parvenir à recréer, des décennies plus tard et hors du pays, l’ambiance la plus authentique possible d’un Mali disparu.
Après avoir passé plusieurs mois dans le pays au début de l’année, l’équipe avait été contrainte de plier ses bagages et ses quelque 4 tonnes de matériel, puis de rentrer en France. Coronavirus oblige. Ils ont finalement pu revenir en octobre pour finir de tourner, à Podor, Saint-Louis et Thiès, à 70 km de Dakar, le reste du film. Pour des raisons de sécurité, c’est le Sénégal, plutôt que le Mali, qui a accueilli le tournage.
Plusieurs badauds se pressent à l’angle d’une ruelle thiessoise pour observer les caméras et les techniciens qui s’affairent. « Awya », s’époumone l’assistant mise en scène Ferdinand Verhaeghe. Sur le tournage, « action » se dit plutôt en wolof qu’en français, à l’attention des nombreux figurants présents sur le plateau. Quant à la langue française, elle prend souvent un accent marseillais : pour ce film comme pour les précédents, le réalisateur s’est entouré de son équipe historique – « comme une famille », glisse son coproducteur et ami Malek Hamzaoui, qui l’a accompagné sur la quasi-totalité de ses longs-métrages.
UNE SOIXANTAINE DE RÔLES, PRÈS D’UN MILLIER DE FIGURANTS, DES DIZAINES DE VOITURES D’ÉPOQUE…
« L’idée d’associer cette histoire de construction du socialisme indépendant panafricain, et de la fête, des jeunes gens qui s’aiment, me semblait être la matière d’un film très riche où je pouvais retrouver mes thèmes principaux », explique Robert Guédiguian, que nous retrouvons à la fin de la journée de tournage. Du personnage principal de Samba, qu’il décrit comme un idéaliste, il dit se « sentir très proche » : « son histoire, c’est un peu la mienne. » D’ailleurs, il lui a prêté sa moto personnelle, qui date des années 1960, et qu’il a fait venir spécialement de France pour les besoins du film.
Voitures d’époque, devantures refaites, tenues « sixties » … L’atmosphère du Bamako d’il y a soixante ans est recréée à Thiès. La gare de la ville, où passait la fameuse ligne Dakar-Bamako, a été spécialement rénovée pour l’occasion, avec ses trains verts rutilants qui stationnent sur les voies. Avec une soixantaine de rôles, près d’un millier de figurants, des dizaines de voitures d’époque – dont plusieurs sont venues directement de France –, c’est l’une des plus grosses productions du réalisateur et coproducteur. Budget du film : 5,5 millions d’euros environ. Coproduction franco-sénégalaise des sociétés Agat film & Cie et Karoninka, avec une équipe constituée dans sa majorité de Sénégalais, Mali twist est le 22e film de Robert Guédiguian.
Le Mali de Modibo Keïta
Samba, fils d’un riche industriel bamakois, s’engage dans le socialisme et le panafricanisme à « une époque d’extrême effervescence révolutionnaire et intellectuelle ». Malgré les réticences de son père, qui voit d’un mauvais œil ces changements drastiques qui menacent ses privilèges, il croit au développement révolutionnaire et rêve d’une véritable et totale indépendance pour son pays. Il finira par se heurter aux réalités de la politique.
À l’époque, à Bamako et dans les campagnes, les militants de la décolonisation tentent de développer la santé et l’éducation, partagent à leurs concitoyens leurs idées de coopérative, de réforme agraire et de droits des femmes. Le mouvement est porté par le charismatique Modibo Keïta, ancien instituteur devenu parlementaire français, qui deviendra l’un des champions du panafricanisme. C’est lui qui proclame, le 22 septembre 1960, l’indépendance de son pays, quelques mois après l’échec de l’éphémère Fédération du Mali qui unissait son pays au Sénégal.
Cofondateur de l’Organisation de l’unité africaine en 1963, militant tiers-mondiste, le Malien gouverne jusqu’en 1968. Soumis à une contestation populaire grandissante, accusé de dérives dictatoriales, il sera renversé dans la nuit du 18 au 19 novembre 1968 par une poignée de militaires conduits par le lieutenant Moussa Traoré.
De quoi laisser nostalgique Robert Guédiguian. « En voyant le Mali d’aujourd’hui, je rêve du Mali de Modibo Keïta », glisse-t-il. « Nous n’étions pas prêts au socialisme, et sans socialisme il n’y a pas d’indépendance », fera-t-il dire à Namori, l’un de ses personnages, un officiel de l’Etat malien. « Et j’y crois profondément… en même temps, forcément, c’est moi qui l’ai écrit », sourit le réalisateur.
Indépendance et décolonisation
À travers son film, il aborde notamment la question de la bourgeoisie nationale, aux manettes au moment de la colonisation, à qui il impute la responsabilité de l’échec de l’expérience : « Ce qui n’a pas abouti au Mali reste pour l’essentiel la responsabilité des riches Maliens de cette époque-là. Des traditionalistes, qui ont organisé une contre-révolution parce qu’ils se sentaient dépossédés par le pouvoir et qui étaient aussi accompagnés de manière plus ou moins discrète par l’ancien colon. D’ailleurs, les manifestations contre-révolutionnaires à cette époque n’hésitaient pas à louer la gloire de de Gaulle, rappelle-t-il. Il y avait quelque chose d’assez cocasse dans le fait de réunir 500 figurants qui gueulaient “Vive de Gaulle” devant la mairie de Thiès. »
Une manière de réfléchir aussi aux mécanismes selon lesquels les indépendances de ces années-là se sont transformées en « dépendances néocoloniales », pour reprendre le mot du réalisateur, « plutôt triste » de voir, dans le Sénégal d’aujourd’hui, l’omniprésence des grandes entreprises françaises. « Aujourd’hui plus que jamais, il est indispensable de se demander pourquoi certaines expériences formidables n’ont pas fonctionné. Il est bien pour le Mali, pour la France, pour tous les pays du monde, de réfléchir aux expériences révolutionnaires qu’ils ont connues, de se souvenir de leurs réussites et de réfléchir à leurs échecs », estime Robert Guédiguian.
Les problématiques, très actuelles, résonnent avec certains questionnements de ses deux acteurs principaux, Stéphane Bak (24 ans, français d’origine congolaise) et Alice Daluz Gomez (19 ans, française d’origine cap-verdienne). « Cette histoire me parle parce qu’elle relève de questions qui se posent sur le continent, confie Stéphane Bak, où les jeunesses se lèvent, rêvent d’une Afrique plus unie, et ne sont pas entendues. Le film parle d’indépendance et résonne avec tout le travail de décolonisation qui reste à faire. » L’acteur pousse la réflexion jusqu’à « l’été que l’on vient de vivre en France », entre le mouvement Black Lives Matter et les mobilisations contre les violences policières.
ÊTRE RÉVOLUTIONNAIRE, C’EST FAIRE LA FÊTE, C’EST UNE TRANSFORMATION DU MONDE EN PERMANENCE »
Et de convoquer les références de Frantz Fanon ou d’Aimé Césaire, cités dans le film, comme une manière de « mieux comprendre [ses] plaies ». « Je ne sais pas si ça se fait beaucoup dans le cinéma français de rendre hommage à ce type de modèles. Des réalisateurs engagés là-dessus, on en compte peu en France, et je savais que Robert Guédiguian avait une façon de poser son regard sur l’Afrique et sur Modibo Keïta qui me correspond. »
Même constat pour Alice Daluz Gomez, dont c’est le premier long-métrage. « Avec ce film, j’ai envie de connaître davantage l’histoire du Cap-Vert », assure-t-elle. La jeune actrice a aussi découvert à travers le projet que le communisme ne correspondait pas tout à fait à la vision « ringarde » qu’elle en avait : « En fait, le communisme, ça n’est pas que Staline et l’URSS ! »
Au festival de Cannes ?
Assis en face d’elle, Robert Guédiguian sourit, lui qui nous confiait un peu plus tôt lancer un « appel à revisiter le communisme » : « Être révolutionnaire, c’est faire la fête, c’est une transformation du monde en permanence. La radicalisation révolutionnaire de mes personnages ne s’oppose pas à la sensualité ou à la vitalité, au contraire. »
Le film, actuellement en cours de montage, devrait être achevé dans le courant du mois d’avril 2021. Il pourrait sortir en France en fin d’année prochaine. Au Sénégal, « aucune stratégie de distribution n’a encore été mise en place », confie la coproductrice Angèle Diabang. Elle est la directrice de la maison de production Karoninka, société créée en 2006 et basée à Dakar. « Mais le film sera forcément présenté aux Sénégalais », ajoute-elle. Pourrait-il mettre en lumière certains talents sénégalais, à l’instar d’Atlantique de Mati Diop (2019), Grand prix du festival de Cannes ?
« Depuis Tey (2013) et Félicité (2017) d’Alain Gomis, on assiste à un certain renouveau et un engouement pour le cinéma sénégalais, observe la productrice. Avec la complication de la situation sécuritaire au Mali, mais aussi au Burkina, qui est un grand pays de cinéma, les tournages se détournent également vers la Côte d’Ivoire ou le Sénégal », comme ce fut le cas pour Mali Twist. Les producteurs espèrent d’ailleurs présenter le film aux festivals de Cannes et de Venise cette année. Et le voir participer, lui aussi, au « rayonnement de la filmographie au Sénégal », ajoute Angèle Diabang.
LE SÉNÉGAL, TERRE PROMISE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE ?
Le Sénégal a déjà donné au continent plusieurs cinéastes de renom, à l’instar d’Ousmane Sembène, Mahama Johnson Traoré ou encore Djibril Diop Mambéty. Aujourd’hui, les succès des œuvres d’Alain Gomis ou de Mati Diop laissent espérer un nouvel âge d’or du cinéma national. Présenté lors de l’édition 2019 du festival de Cannes, Atlantique est le premier film à avoir été sélectionné en compétition officielle depuis Hyènes de Djibril Diop Mambéty, en 1992. En 2016, l’État sénégalais créait un fonds spécial pour soutenir la production nationale, le Fopica (Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle), doté d’un milliard de francs CFA (1,5 millions d’euros). Mais c’est surtout au niveau de sa production télévisuelle que le pays s’est distingué ces dernières années. Le public sénégalais, friand des telenovelas latino-américaines, s’est progressivement laissé séduire par les nouvelles séries nationales. En 2019, le succès fulgurant de la série Maîtresse d’un homme marié (Marodi production), dont chaque épisode cumule facilement plusieurs millions de vue sur Youtube, a contribué à cet essor. Souvent tournées en wolof et sous-titrées en français pour toucher la diaspora africaine et le reste du continent, des séries comme Infidèles ou Golden continuent de surfer sur ce succès.







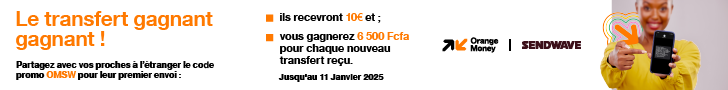




” … Pour des raisons de sécurité, c’est le Sénégal, plutôt que le Mali, qui a accueilli le tournage… ” …///…
:
Ils ont pu trouver L’atmosphère du Bamako des années 1960 au Sénégal avec uniquement des acteurs non Maliens… ?
Les Bamakois des années ” 60 ” y reconnaitront-ils les Rues de Bamako et leurs ambiances ?
Suspens donc… !
Vivement la paix au Mali,
et que, s’il y a une suite du Films…, que les prochains tournages puissent avoir lieu dans les Rues de Bamako…, avec des Acteurs Maliens, Sénégalais et autres Africains.
https://m.youtube.com/watch?v=jJyKTilOQXA
Comments are closed.